Version imprimable de Métaphysiques de la prédation
Charles Stépanoff
Métaphysiques de la prédation
Conclusion de l’essai L’animal et la mort
La Découverte, 2021
« Après tout, le moyen le plus simple d’identifier
autrui à soi-même, c’est encore de le manger. »
Claude Lévi-Strauss, « Nous sommes tous des cannibales », 2013 [1993].
L’un des plus puissants et épineux paradoxes de notre rapport moderne aux animaux est un étrange mélange de sensibilité extrême et d’insensibilité endurcie. Pour le philosophe Baptiste Morizot, la crise écologique actuelle est en grande partie une crise de la sensibilité. Les oiseaux disparaissent de nos horizons en même temps que notre capacité d’entendre leurs chants, de les reconnaître et de nous y intéresser. Devant une prairie fleurie résonnant de myriades de cris, de bourdonnements, de messages d’amour et de menaces qu’émettent passereaux, insectes et petits mammifères, nous n’entendons rien, nous ne percevons que le « silence reposant » que l’on vient chercher à la campagne [1].
Or, d’un autre côté, notre parcours historique nous a montré que l’âge moderne est caractérisé par le progrès et la généralisation d’une forme de sensibilité aiguë à la souffrance animale, entérinée par une législation toujours plus protectrice. Nous sommes devenus incapables de mettre à mort le poulet que nous mangeons, écraser un insecte nous est pénible et les pratiques cruelles envers les animaux nous heurtent. Alors qu’il nous est difficile de distinguer un sansonnet d’une grive, ou même une chèvre d’une brebis, nous sommes remplis de respect envers ces êtres que nous ne savons plus ni nommer ni comprendre. Comment expliquer ce décalage ? Existerait-il plusieurs manières d’être « sensible » au vivant, dont l’une pourrait se développer tandis que l’autre déclinerait ?
Revenons à notre terrain pour tenter de voir plus clairement comment se manifestent ces formes de sensibilité. L’une des surprises de l’enquête fut pour moi de découvrir que chasseurs et militants antispécistes affirment les uns comme les autres « se mettre à la place » des animaux. Or, évidemment, adopter la perspective des bêtes les conduit à des attitudes opposées. Quelles sont donc les différences entre ces deux sortes de projection dans l’altérité en termes d’opérations cognitives et d’affects ?
Quand les militants disent qu’ils se mettent à la place de l’animal pourchassé, ils soulignent qu’ils perçoivent ses souffrances et ses angoisses et font référence à ses états intérieurs. Beaucoup reconnaissent demeurer longtemps bouleversés après avoir observé ou simplement visionné en vidéo des scènes de chasse, comme s’ils éprouvaient eux-mêmes une part de la détresse de l’animal.
Les chasseurs qui « se mettent à la place du cerf » pour le traquer font référence à tout autre chose : ils s’intéressent à ses interactions avec ses congénères et ses prédateurs, à sa mémoire des lieux et à ses représentations mentales concernant ses poursuivants. Il ne s’agit pas pour eux d’explorer l’intériorité de l’animal, mais plutôt de voir le monde extérieur à travers ses yeux. En interprétant ses indices et ses messages, en supputant ses « ruses », ils dessinent une imbrication de représentations transitives en chaîne : ils explorent les représentations que le cerf forme sur les représentations que les chiens se font à son sujet et cherchent à les déjouer.
Nous avons vu comment ces deux manières de se mettre à la place se différenciaient déjà au XVIIIe siècle entre des auteurs chasseurs soulignant l’intelligence et les compétences communicationnelles des animaux et des philosophes mettant l’accent sur la capacité des animaux à souffrir (« La question n’est pas “peuvent-ils raisonner ?”, ni “peuvent-ils parler ?”, mais “peuvent-ils souffrir ?” »). Pour les philosophes, la compassion consistait à « souffrir avec » en un sens non seulement psychologique mais physique : face à la souffrance animale, l’homme empathique « sent la douleur dont il est le témoin ; il frémit, ses entrailles sont déchirées, sa poitrine comprimée, ses nerfs resserrés et son sang glacé dans ses veines [2] ».
Une différence évidente entre le perspectivisme des animalistes et celui des chasseurs tient à ce que ces derniers explorent le point de vue de l’animal sans pour autant l’adopter : par exemple, le chasseur qui sait que le cerf voit les chiens comme des prédateurs dangereux ne les regarde pas lui-même ainsi, mais comme des « petits gars » affectueux. Le chasseur tient donc séparées deux perspectives : la sienne propre et celle de sa proie, ce qui lui permet de manipuler cette dernière. C’est d’ailleurs un trait probablement universel de la chasse que l’anthropologue Rane Willerslev a bien mis en lumière sous le nom de « double perspective » chez les Yukaghir de l’Arctique sibérien qui se gardent d’adopter le point de vue de l’élan qu’ils poursuivent au risque de devenir fous [3]. Prédateur empathique, le chasseur humain doit imposer des limites à son empathie et éviter de laisser le point de vue de sa proie envahir le sien.
Pour synthétiser, on pourrait ainsi distinguer une sensibilité, incarnée dans notre enquête par les chasseurs, qui lit des indices pour reconstituer un monde de relations et une sensibilité devenue dominante dans la modernité, personnifiée ici par les animalistes, qui s’intéresse en premier lieu à l’intériorité des animaux, en tant que sujets sensibles.
Sans prétendre expliquer les différences entre ces deux sensibilités par un modèle psychologique mécaniste, on devine toutefois que l’une et l’autre font appel à des ressorts mentaux nettement distincts. Les recherches du neurophysiologiste Alain Berthoz, et notamment sa « physiologie du changement de point de vue », peuvent ouvrir ici des pistes éclairantes. Berthoz distingue « empathie » et « sympathie » comme deux processus différents dans les relations à autrui. Par la sympathie, j’entre en résonance avec la personne que je vois rire ou souffrir, ses émotions me gagnent comme par contagion, je les laisse entrer en moi-même. Dans l’empathie, en revanche, je ne souffre pas de la souffrance d’autrui, mais je regarde mentalement les choses de son point de vue. L’empathie met en œuvre à la fois un mécanisme de projection vers autrui et une inhibition de l’émotion.
Sur le plan neurologique, la sympathie (ou compassion) mobilise les neurones-miroirs alors que l’empathie implique la cognition spatiale en accomplissant un « voyage mental » dans le corps d’autrui pour percevoir l’espace tel qu’il lui apparaît [4]. Ces stratégies cognitives ne sont pas des traits de caractère personnels, mais peuvent être mobilisées selon les circonstances ou les contextes sociaux : par exemple, un médecin évitera de se laisser envahir par la souffrance de chacun de ses patients et adoptera une attitude d’empathie, ce qui ne l’empêchera pas de pleurer de sympathie le soir en voyant un mélodrame au cinéma.
D’un point de vue anthropologique, on peut supposer que certains contextes sociaux et traditions culturelles favorisent plutôt la sympathie ou l’empathie. Il est aisé de reconnaître que l’attitude animaliste cultive plutôt la sympathie, tandis que les chasseurs ont tendance à mobiliser l’empathie [5]. Les émotions vécues par les animalistes peuvent s’alimenter de vidéos et d’images isolées de leur contexte social et écologique, car c’est le face-à-face dyadique de l’animal et de l’humain qui permet la contagion compassionnelle. Pour les chasseurs ruraux en revanche, l’interaction avec l’animal sauvage, si elle peut être une source de vive émotion, n’est pas pertinente seule : elle s’insère dans un mode de vie et un rapport au territoire, à la forêt, au bocage qui forment l’habitat partagé par le chasseur et la bête et le décor de leurs interactions au quotidien, bien au-delà du moment de la chasse.
Ce que nous avons appelé la chasse terrestre est fondé sur une relation triadique hommes-animaux-terre : il n’y a pas d’accès aux animaux sans passer par l’intimité avec le territoire, pas plus qu’il n’y a d’accès aux profondeurs cachées de la terre sans un rapport nourricier à l’altérité qu’est le gibier sauvage. Ce sont la fréquentation des lieux et le travail conduit toute l’année sur le territoire qui légitiment la chasse terrestre et la distinguent de la chasse commerciale et du safari centrés sur une rencontre ponctuelle avec un animal inconnu sur un territoire éloigné du lieu de vie.
Ces dernières décennies, les travaux des sciences sociales ont abondamment documenté les enjeux d’autochtonie dont la chasse est porteuse : en Cévennes, elle rétablit une communalité gratuite du territoire face à l’emprise de l’État et à l’appropriation des terres par des acheteurs étrangers ; en Vendée, le renouveau de la chasse à courre traduit un effort pour maintenir le sens de la communauté et de l’identité rurale anti-urbaine ; ailleurs, les sociétés communales défendent un « droit d’usage collectif des habitants sur un terroir, par lequel se traduit l’appartenance (réelle ou rémanente) d’individus à une communauté rurale, en bref leur autochtonie [6] ». Cette notion d’« autochtonie », commune à l’ethnologie et à la sociologie, désigne une forme de légitimité qui ne se fonde pas sur la possession d’un capital économique ou culturel, ni sur des réseaux sociaux uniquement humains, mais sur un rapport de familiarité au terroir et à ses habitants humains et non humains. L’autochtonie, exprimée dans le sentiment d’appartenir à un lieu plutôt que de le posséder, est souvent la seule ressource symbolique défensive de communautés face aux entreprises d’accaparement et de stigmatisation de groupes sociaux à capital économique ou culturel élevé.
Pourquoi la chasse exprime-t-elle si régulièrement pour des communautés locales des revendications d’autochtonie, en France comme dans d’autres régions du monde ? Sans doute à cause de l’intimité avec les dimensions cachées du territoire qu’exige cette activité, intimité interprétée comme un lien à la souveraineté et aux puissances immaîtrisables de la terre que nous avons vues hypostasiées en Sibérie sous les traits d’esprits maîtres des animaux. En effet, la configuration triadique hommes-bêtes-terre revêt dans le mode de vie des chasseurs sibériens un caractère particulièrement explicite et même religieux. Les animaux appartiennent à la terre et seule une bonne relation de longue durée avec les puissances terrestres peut autoriser à s’en nourrir.
Dans les conflits actuels autour de pratiques de chasse, les configurations dyadique et triadique du rapport à l’animal mobilisent des épistémologies différentes, des formes contrastées d’accès au savoir. Les militants animalistes revendiquent un mode de pensée fondé sur le jugement éthique, l’expérience intime et la prise de conscience individuelle. Attachés à une logique émancipatrice, ils considèrent que le rejet de normes sociales et de comportements transmis par héritage est une condition de l’avènement d’une pensée individuelle autonome. Ainsi, les traditions rituelles de la chasse leur apparaissent comme un « poids » venu des ancêtres auxquels les veneurs se soumettraient par manque de réflexion personnelle. Les sources légitimes de savoir sont scientifiques ou journalistiques plutôt que familiales et, si une transmission verticale a lieu, elle se fait souvent des jeunes générations vers les plus anciennes, notamment lorsque des jeunes convainquent leurs parents de devenir végétariens et de renoncer à leurs anciennes habitudes à l’égard des animaux.
De leur côté, les chasseurs paysans font souvent référence dans leurs discours aux « anciens », à leur sagesse, leurs pratiques et leurs savoirs écologiques. Ils conçoivent la chasse comme l’exercice de droits collectifs liés à l’appartenance familiale, à la connaissance des lieux et au travail sur le territoire. Dans l’affrontement autour de la chasse à courre, ce ne sont pas des époques différentes qui se heurtent, car toutes les parties prenantes sont contemporaines, mais des philosophies hétérogènes du temps. Alors que les militants estiment que les origines médiévales de la vénerie la rendent inadaptée aux exigences morales de notre époque, pour les amateurs, une grande part de son intérêt vient justement de son ancienneté. Cet ouvrier qui suit un équipage depuis son enfance en convient : « Ben oui, c’est une pratique d’un autre temps, c’est ancien, c’est du temps des rois, tout ça. Et alors ? » Beaucoup reconnaissent éprouver lors des chasses à courre une impression de « sortir du temps » qui leur fait oublier les contraintes du quotidien. Plutôt qu’un voyage en arrière, ils vivent la vénerie comme une appartenance à une communauté temporelle élargie, dans laquelle les époques se rencontrent et fusionnent. Ce temps lent, épais et mêlé, qui laisse une voix aux défunts et une place aux souvenirs même non vécus, diffère du temps immédiat, transparent et purifié, soumis à une exigence de cohérence morale, dans lequel la modernité tend à inscrire les subjectivités.
Les communautés élargies de la chasse rendent poreuses les limites entre les époques mais aussi entre les espèces en nouant des liens d’identification entre animaux et humains. Entre Perche et Beauce, nous avons vu que la chasse paysanne affirme un lien substantiel avec la petite faune, perdrix, lapins, lièvres, et revendique des valeurs de modestie et de franche camaraderie associées au comportement discret et familier de ces animaux, toujours au seuil du sauvage et du domestique. En petite vénerie, les équipages de lapin et de lièvre sont attachés aux mêmes valeurs populaires et se veulent « modestes », à la différence des équipages de cerf qui sont « une affaire de gens riches qui parlent affaires ». « Tout en finesse » est la devise de l’équipage de lièvre que j’ai suivi. Quant aux veneurs de sangliers, ils ont, comme leur animal, une réputation de « bourrins ».
Chaque groupe exalte les qualités de son animal : ceux qui courent le renard affirment que le goupil est plein de ruse et d’adresse sportive, il grimpe aux arbres, monte sur les toits des bâtiments, se cache sous terre. L’équipage s’attribue les mêmes qualités et imite sa conduite amphibie, grimpant à sa suite ou s’enfonçant dans la boue à coups de pioche pour le débusquer au terrier. Pour ces passionnés du renard, « chasser le cerf, c’est comme chasser des vaches, ça n’a aucun intérêt, il ne se passe rien ». La correspondance est frappante entre type de chasse et niveau dans l’échelle sociocosmique : depuis les déterreurs qui fouillent les profondeurs chtoniennes à l’image des blaireaux jusqu’aux notables dressés sur leurs chevaux en quête du cerf christique à travers les hautes futaies. La correspondance va plus loin que la projection analogiste entre un ordre social hiérarchisé et un ordre naturel, car chaque groupe partage avec son animal-totem une manière de voir le milieu vivant, un esprit, mais aussi un habitus et une posture corporelle. C’est l’esquisse d’une identification totémiste inachevée qui se discerne, semblable aux rapports fusionnels de corps et d’esprit que certains clans algonquiens d’Amérique du Nord nouent avec leur totem, l’animal dont ils sont les chasseurs spécialisés [7].
Pourquoi ces différentes formes de chasse, pratiques incontestablement archaïques, ont-elles subsisté jusqu’à aujourd’hui dans l’Occident moderne ? Dans la chasse, l’homme se met à l’épreuve de l’imprévisible, alors que la modernité a eu pour but de créer par le progrès technique des conditions de vie prospères permettant d’échapper aux aléas de la nature, maladies, sécheresses, nuisibles. En elle s’articule depuis le Néolithique un certain type de rapports de symétrie et d’interdépendance entre l’imprévisibilité du monde sauvage et l’intimité rassurante du monde domestique. L’activité de chasse implique l’existence de formes de vie autonomes, insoumises au contrôle humain, capables de lui résister et de le mettre en défaut. Dans les sociétés agropastorales, le maintien de la chasse implique une autolimitation de la volonté de défrichement et de domestication du monde, c’est pourquoi les attitudes de protection de la faune et des milieux sauvages sont historiquement nées dans le monde des chasseurs : ce sont les paradis mésopotamiens, les forestes et les parcs de chasse en Europe. Protéger les forêts est souvent entré en conflit avec le processus de mise au travail de la terre, comme l’illustrent les heurts entre chasseurs et moines défricheurs – même si, au cours des siècles, c’est surtout contre les empiétements des paysans dans les forêts que les princes ont exercé leur pouvoir répressif. C’est à la violence inflexible du pouvoir cynégétique que nous devons en France l’existence de vastes domaines forestiers et de riches populations de cerfs.
De manière plus inattendue, les chasseurs n’ont pas simplement été les porteurs en Occident d’un effort de protection des milieux sauvages, ils ont également contribué à populariser une attitude de compassion à l’égard des bêtes. La poésie du Moyen Âge puis les traités de chasse à partir de la Renaissance montrent que, pendant longtemps, se mettre à la place du cerf impliquait de façon combinée l’exploration mentale des rouages de ses ruses et celle des arcanes de ses sentiments, unissant l’empathie à la sympathie. Or empathie et sympathie se sont progressivement désolidarisées à partir du XVIIIe siècle quand, par un processus de schismogenèse, certains groupes se sont spécialisés dans un combat de plus en plus naturalisé avec le cerf, dont les larmes se figeaient en cire inexpressive, tandis que des « hommes sensibles » cultivaient pitié et contagion des pleurs.
Au début du XXe siècle, un travail d’épuration morale a fini par rendre la présence des chasseurs d’élite eux-mêmes inadmissible dans les rangs des institutions de protection de la nature, comme l’ont manifesté une série d’exclusions et de démissions. Une forme de protection de la nature sans mélange prenait le dessus.
C’est que les chasseurs n’ont jamais eu le monopole de la compassion envers les bêtes sauvages ; une figure ancienne l’a incarnée de façon bien plus efficace et épurée : celle de l’ermite. Entouré d’animaux dans sa hutte ou sa grotte, l’anachorète personnifie l’apprivoisement bienveillant et protecteur du sauvage. À l’âge moderne, cette figure se démocratise, philosophes et poètes se posent en nouveaux ermites revendiquant des liens d’amitié avec les bêtes. L’image du cerf familier implorant ses protecteurs, empruntée à Virgile, est étendue par Montaigne et Pope pour devenir parangon de l’animal sauvage, consacrant de façon frappante l’expansion séculaire du paradigme de l’apprivoisement.
Bien entendu, le vieil érémitisme s’est métamorphosé au passage : il n’est plus un mode de vie ancré dans une quête religieuse, mais une fiction épisodique fondée sur une alternance entre civilisation et ressourcement dans la nature, qui rappelle plutôt le rythme des anciens princes chasseurs. L’attitude moderne de l’amour protecteur de la nature naît ainsi de la fusion inattendue entre l’éthique de bienveillance des pieux solitaires et une définition de la nature comme espace récréatif expurgé des activités productives par les seigneurs chasseurs.
Ce qui distingue la protection érémitique de la protection cynégétique et ce qui la rend plus pure, c’est qu’elle est végétarienne et déploie dans l’apprivoisement une relation d’appropriation sociale seule, tandis que la chasse mêle appropriation sociale et corporelle par l’adoption de certains animaux sauvages et la consommation de la chair des autres. L’attitude de protection bienveillante crée une asymétrie entre protecteur et protégé : en exerçant sa compassion, l’humain se sépare moralement du monde protégé et s’élève au-dessus de lui. Le scénario du sauvetage de l’animal en détresse, très populaire dans les médias et les réseaux sociaux, manifeste le succès de ce paradigme aujourd’hui. La relation cynégétique se distingue en ce qu’elle met en scène un affrontement symétrisé avec la bête et instaure une dépendance de l’humain à l’égard du monde sauvage en ritualisant une incorporation physique de l’altérité. L’animal sauvage est tué pour que sa force vitale soit en partie appropriée. Dans les sociétés étatiques, les seigneurs et les rois se sont réservé le privilège de cette confrontation avec le monde sauvage pour se nourrir des substances vivifiantes et y renouveler le prestige de leur force souveraine. L’effondrement de la mystique cosmopolitique du pouvoir et son remplacement par le modèle du contrat entre humains, sans participation des non-humains, a progressivement conduit les élites à renier comme salissantes et barbares ces liturgies sauvages, les abandonnant aux milieux populaires ruraux. La consommation des testicules, privilège de la bouche du roi au XVIIIe siècle, est devenue au XXe siècle le fait d’individus peu recommandables, braconniers et chasseurs enragés. La communion aux puissances sauvages a été perpétuée par des hommes de la forêt, bûcherons, piégeurs, suiveurs de chasse à courre qui continuent aujourd’hui, avec une piété joyeuse, d’ingérer le sang et la chair noire des bêtes. Or, depuis peu, l’identification consubstantielle aux bêtes est redécouverte par des groupes sociaux plus diversifiés, incluant des femmes, à travers les étonnantes cérémonies néobarbares que nous avons découvertes, comme le baptême du sang.
Des éléments du monde sauvage pénètrent l’univers domestique par l’alimentation, les trophées et les adoptions d’animaux sauvages, tandis que les humains eux-mêmes apportent de façon réciproque différents dons au monde sauvage : autrefois don au corbeau en vénerie, offrande aux martinets lors des moissons, part du loup à laquelle le prédateur a droit de tout temps ou oblations de récolte et même de bestiaux vivants aux forces sauvages en Europe centrale, aujourd’hui affouragements et agrainages. Il en ressort un tableau poreux des rapports d’interpénétration entre le sauvage et le familier dont le lacis du bocage nous a donné l’incarnation paysagère.
Au fond, ce sont des conceptions différentes des rapports entre identité et altérité qui sont en jeu dans les schèmes relationnels qui s’affrontent autour de la faune sauvage. Selon le paradigme moderne de l’exploitation-protection, la nature est une extériorité dans laquelle on puise des ressources ou que l’on contemple, que l’on domine en la transformant en marchandise ou en lui prodiguant des soins protecteurs, mais avec laquelle on ne se mélange pas, qui n’entre pas dans la constitution de notre identité, sauf à risquer la « bestialité » et la « barbarie ». Dans la prédation, le sauvage est aussi une extériorité, mais une extériorité nécessaire, symétrisée, constitutive de l’intériorité dans sa physiologie même.
La consommation de chair prolonge et parachève étrangement la projection empathique dans la perspective de l’animal. Claude Lévi-Strauss interprétait ainsi la philosophie du cannibalisme comme une façon extrême de se mettre à la place d’autrui : « Jean-Jacques Rousseau voyait l’origine de la vie sociale dans le sentiment qui nous pousse à nous identifier à autrui. Après tout, le moyen le plus simple d’identifier autrui à soi-même, c’est encore de le manger [8]. » Les analyses des anthropologues amazonistes ont apporté un éclairage nouveau à ce que Lévi-Strauss nommait la « métaphysique de la prédation » : chez les peuples pratiquant la chasse et le cannibalisme, l’incorporation physique de l’ennemi, animal ou humain, met en jeu une transmutation des perspectives où l’altérité est nécessaire à la constitution du « je ». L’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro résume ainsi cette philosophie : « Le “je” est déterminé en tant qu’“autre” par l’acte d’incorporation de cet autre, qui à son tour devient un “je”, mais toujours dans l’autre, littéralement à travers l’autre [9]. » La société humaine n’a pas d’intérieur, elle ne peut être elle-même qu’en sortant de soi et en incorporant une extériorité par la capture de ressources symboliques, faites d’âmes, de chair et de trophées à travers la guerre et la chasse.
Par comparaison, il est clair que la modernité se constitue en reconfigurant les rapports entre intériorité et extériorité autour d’une conceptualisation hermétique des catégories et des identités qui rend impossible l’interpénétration et la qualifie en désordre pathologique quand elle survient. L’enjeu profond n’est pas dans l’existence de catégories telles que sauvage et domestique, nature et culture, car tous les collectifs humains produisent des catégories ; il est dans la nature des limites entre catégories : interfaces poreuses permettant de troubles circulations chez les non-modernes ; frontières à protéger des incursions étrangères pour les modernes.
C’est au cours de ses enquêtes de terrain chez les chasseurs aborigènes australiens que l’ethnologue Deborah Bird Rose a découvert l’expérience de la mise à mort d’animaux et a appris à voir la lumière de la vie s’éteindre dans les yeux d’un être vivant. Face au premier commandement de la loi mosaïque, « Tu ne tueras point », Deborah Bird Rose oppose une formule qui exprime selon elle l’éthique des chasseurs-cueilleurs : « Tu ne détourneras point les yeux de la mort des animaux [10]. » Il y a probablement une métaphysique tacite de la responsabilité et de la socialisation de la violence dans l’acte de mise à mort sans détourner les yeux et sans délégation à autrui. Cette métaphysique est obscure et mal exprimée, à la différence de la métaphysique inverse de détournement du regard et de l’occultation, élaborée et magnifiée par de nombreux auteurs de la modernité pour qui la pacification des mœurs est la condition première de la civilisation. Tuer sans détourner les yeux, c’est, selon Deborah Bird Rose, admettre que notre vie dépend de la mort des autres et que nous absorbons des morts tout au long de notre existence. « En opposition au rapport tactile et immédiat que tuer et manger supposent et qui, quand nous chassons, nous immerge instantanément dans un univers de rencontres, de droits et d’obligations réciproques, les sociétés occidentales préfèrent largement occulter les grandes quantités de morts sur lesquelles reposent nos vies, directement ou indirectement [11]. »
La violence de la chasse doit en effet être considérée dans le contexte plus global des autres formes de violence anthropique produites par la modernité occidentale. Elle pose la question d’une résistance en Occident au processus millénaire de division du travail moral, grâce auquel la violence, toujours plus contaminante et crainte, a pu être en même temps camouflée et démultipliée de façon incontrôlée. Manger ce que l’on tue et tuer ce que l’on mange, c’est maintenir la violence à un niveau proche et social, c’est la garder sous contrôle et l’entourer des égards dus à ceux qui nous nourrissent, qui constituent notre chair de leur mort et qui survivent ainsi dans les palpitations de nos corps. Les chasses terrestres réaffirment une dépendance des humains à l’égard du vivant et une insertion de notre espèce, parmi les autres, dans le cycle infini des prédations.
En résistant à la logique de la division du travail moral, les chasses terrestres maintiennent une zone trouble et une morale mêlée dans un contexte de développement d’éthiques purifiées et d’attitudes sans mélange. À ce titre, le parallèle est frappant entre le mouvement de simplification des milieux écologiques, avec la disparition des mosaïques et des corridors des bocages ou des bois paysans analysés par Anna Tsing, et le phénomène de simplification cognitive que Jack Goody identifie dans la généralisation d’une pensée dominée par l’écriture à l’époque moderne [12]. Les rapports d’implication réciproque et d’interpénétration, les zones troubles et les identités complexes cultivées dans les cosmologies non modernes n’ont pas de place dans les taxinomies catégorielles des grands tableaux classificateurs de l’ordre graphique savant. Un être, une couleur, un affect appartiennent soit à une espèce, soit à une autre, mais pas à deux à la fois.
Le lien historique et logique est intime entre l’avènement d’une rationalité catégorielle rigide et la spatialisation des catégories mentales dans des paysages clivés. Lieux de production intensive, zones de forêts, parcs de loisirs, aires d’habitat et de travail segmentent à la fois nos vies, nos territoires et nos esprits. Ces dernières années, conflits d’usage, incompatibilités éthiques et nécessités de contrôle de la faune entraînent un cloisonnement accéléré des espaces, comme l’illustrent les centaines de kilomètres de clôtures qui viennent séparer forêts et terres cultivées. Une même logique de division du travail et de séparation exclusive s’applique à des catégories d’êtres vivants (animaux de compagnie et animaux-matière), à des paysages (réserves naturelles et zones de production) et à des attitudes morales (amour protecteur et exploitation capitaliste).
Or ce paradigme auquel nous sommes habitués n’est pas le seul possible. Nous avons besoin d’élargir nos modèles afin d’imaginer d’autres rapports au vivant qui ne soient pas d’un seul tenant, mais riches de leur complexité même. En ce domaine, les mythologies et les rites des peuples de chasseurs et d’éleveurs peuvent nous servir de guides. Les paradoxes de leurs rapports aux non-humains reçoivent des formulations d’une réflexivité profonde. Souvenons-nous du mythe inughuit qui mettait en garde contre l’éclatement entre le camp de l’amour protecteur figuré par la femme à l’ours apprivoisé et le camp de la violence incarné par les chasseurs impitoyables. Les mondes autochtones nous rappellent que préserver une autonomie à la fois vivrière et morale nécessite un polymorphisme des éthos capable de nourrir un milieu relationnel riche.
Notre monde souffre d’un appauvrissement simultané et corrélé des formes de vie et des modes de vie. Face à une unification mondialisée étouffante, l’enjeu profond des conflits actuels est désormais autant la préservation des espèces que celle d’une diversité de façons d’habiter la terre qui pendant de nombreux siècles ont permis, vaille que vaille, la coexistence des humains et d’une multiplicité d’êtres. Une coexistence qui n’était ni une symbiose idyllique (une fiction qui nous détache du réel) ni une guerre d’extermination (une pulsion qui détruit le réel), mais une amphibiose, les pieds sur la terre. Travaillées par un processus séculaire de civilisation qui les éloigne de l’animalité et de la nature, mais de plus en plus anxieuses des conséquences écologiques de cette rupture, les sociétés modernes vont nécessairement devoir affronter avec lucidité cette question : peuvent-elles admettre en leur sein un pluralisme de cosmologies et de modes de vie, incluant des traditions qui, comme la chasse, ont préexisté à la réorganisation des sensibilités dans le couple déchiré exploitation-protection ?
L’étonnante division rigide entre les êtres exploités qui assurent notre subsistance et ceux qui partagent nos maisons et nos émotions dérive d’une séparation entre production et habitat. C’est parce que porcs, vaches et poules ont quitté nos maisons qu’ils ont pu devenir des animaux-matière. À l’heure où de plus en plus de personnes, notamment dans les jeunes générations, s’interrogent sur la délégation des tâches et souhaitent reprendre en main les conditions de leur survie, il appartient à l’anthropologie d’illustrer la multiplicité des formes de vie résistant à cette alternative : ni protéger le vivant ni l’exploiter, mais en faire un lieu de vie, habiter le vivant et s’en nourrir, dans une relation d’incorporation consubstantielle, qui n’est pas univoque et purifiée mais composite et trouble.
Au terme de cette enquête, gardons espoir dans une ouverture des imaginations à des modes d’existence capables de recréer des écosystèmes biotiques et cosmologiques touffus et bigarrés opposant quelques rugosités au grand lissage des plaines.
Notes
[1] B. Morizot, Manières d’être vivant, op. cit., p. 16-20.
[2] Mémoire de 1803, cité par V. Pelosse, « Imaginaire social et protection de l’animal. Des amis des bêtes de l’an X au législateur de 1850 (1re partie) », art. cité, p. 9.
[3] R. Willerslev, Soul Hunters, op. cit.
[4] Alain Berthoz et Gérard Jorland, L’Empathie, Odile Jacob, Paris, 2004 ; Alain Berthoz et Bérangère Thirioux, « A spatial and perspective change theory of the difference between sympathy and empathy », Paragrana, vol. 19, no 1, 2010, p. 32-61.
[5] Comme on l’a vu, les défenseurs des animaux emploient le terme « empathie » pour désigner des émotions compassionnelles que Berthoz nomme « sympathie ».
[6] M. Bozon, « Chasse, territoire, groupements de chasseurs », art. cité, p. 342. Sur les Cévennes et la Vendée, voir A. Vourc’h et V. Pelosse, Chasser en Cévennes, op. cit., p. 232, et B. Bucher, « Rites et stratégies d’adaptation », art. cité, p. 277. Sur l’autochtonie, voir Jean-Noël Retière, « Autour de l’autochtonie. Réflexions sur la notion de capital social populaire », Politix, vol. 16, no 63, 2003, p. 121-143, et Christophe Baticle, « Le localisme cynégétique à l’épreuve du développement durable. Autochtonie et gestion des territoires dans la Somme », Économie rurale, no 327-328, 2012, p. 152-166.
[7] On se réfère ici à la définition de l’ontologie totémiste par Ph. Descola, Par-delà nature et culture, op. cit., p. 238-240.
[8] Claude Lévi-Strauss, Nous sommes tous des cannibales, Seuil, Paris, 2013, p. 173.
[9] Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales. Lignes d’anthropologie post-structurale, trad. Oiara Bonilla, PUF, Paris, 2009.
[10] Deborah Bird Rose, Le Rêve du chien sauvage. Amour et extinction, trad. Fleur Courtois-l’Heureux, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2020 [2011], p. 50.
[11] Ibid., p. 52.
[12] A. L. Tsing, Le Champignon de la fin du monde, op. cit. ; Jack Goody, La Raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, trad. Jean Bazin et Alban Bensa, Minuit, Paris, 1977.
Charles Stépanoff
L’animal et la mort
Chasses, modernité et crise du sauvage
La Découverte, 2021.
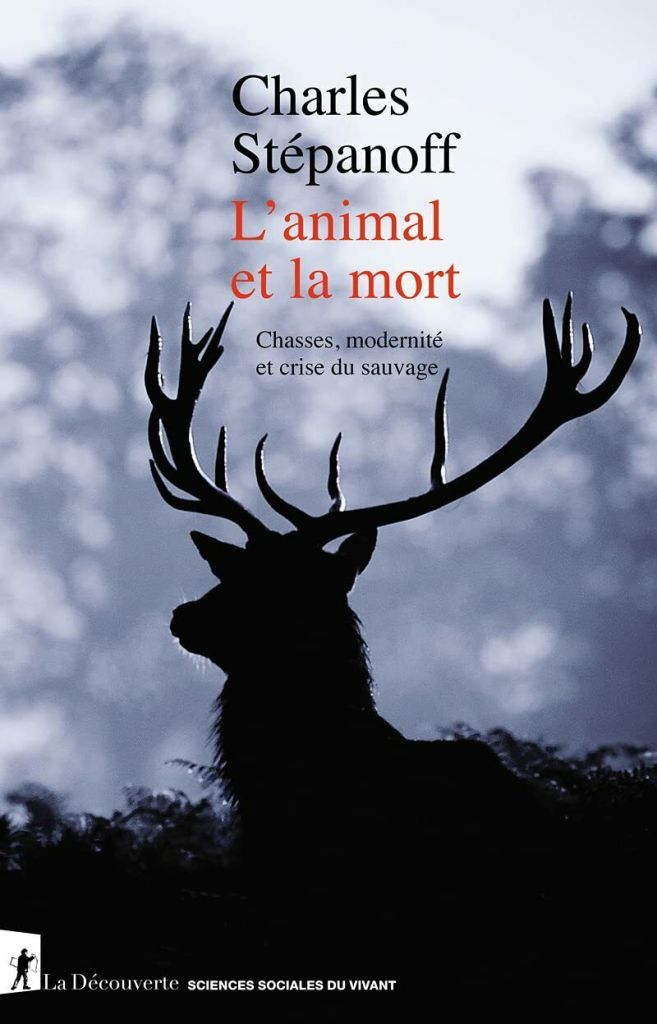
Debra
/ 6 mars 2024Ce matin je suis mauvaise ; je ne vais pas tout lire, d’autant que je viens de passer un moment absolument délicieux en compagnie d’Emmanuel Dodds qui présente « Les Bacchantes » d’Euripide où il est beaucoup question du sujet de cet auteur moderne.
J’ose dire que je partage l’état d’âme d’Euripide quand il a écrit son chef d’oeuvre, dans un grec archaïsant, sur le sujet de la religion dionysiaque, sous la forme de ce qu’on appelle une « passion », comme les « passions » qu’a pu monter l’Eglise avec l’histoire du sacrifice de Jésus, car l’histoire de Jésus raconte une « passion » et un sacrifice.
Dodds discute le contexte de cette avant dernière pièce d’Euripides, écrite… très loin d’une Athènes cosmopolite, intellectualle, SOPHISTIQUEE, etc, en Macédoine, dans les montagnes où il a pu trouver un cadre de nature plus présent, et nettement moins urbain.
Et il y est question de chasser : d’être chassé, de chasser. Il est question d’être déchiré en mille morceaux à la main de femmes furies incontrolables, qui sont comme des bandes de corbeaux, d’étourneaux dévorant tout sur leur passage. Dionysos est à la fois terrible, mais terriblement doux pour l’Homme. Il est incontournable, et on ne peut pas, on ne pourra pas le dompter, le nier, ou le faire disparaître, même avec les meilleures volontés de.. la cité. Essayez de comprendre.
Pour les animaux et leur souffrance… je pense que quand on est dans l’épaisseur de la chasse, comme on dit en anglais, l’animal ne souffre pas, et il ne s’angoisse pas non plus, CAR IL N’A PAS LE LOISIR, LE LUXE, LE TEMPS de tout ça. Il sait qu’il doit se débrouiller, qu’il doit ruser ? qu’il doit faire tout en son pouvoir pour échapper, et il fait de son mieux. Faut-il le prendre en pitié ? Pendant ce temps où il est ENTIEREMENT OCCUPE, ENTIEREMENT PRESENT A LUI-MEME DANS LA NECESSITE de durer, est-il à plaindre ?
Par contre, urbain Athéniendu 4ème siècle avant Jésus Christ, intellectuel assis au théâtre, LIBRE de vaquer à ses occupations en ville, ou urbain contemporain, dans des conditions similaires, peut-être a-t-on le loisir ? le luxe ? la poisse ? de trouver le temps long, de s’angoisser, de fantasmer sur ses angoisses, même. Cela s’appelle une certaine civilisation…
« Les Bacchantes » a l’immense mérite de montrer l’homme SE VOULANT LE GARANT ENTIEREMENT RATIONNEL de l’ordre de la cité dans son extrême imprudence à vouloir éjecter de la vie de l’Homme ce désordre qui habite au fond de l’animal humain, même, ou surtout s’il pense qu’il ne partage rien avec l’animal, même pas… son âme.
La bonne vieille condition humaine, en somme, que je préfère me coltiner avec Euripide, encore et toujours, parce qu’Euripide me prend à bras le corps d’une manière que nos contemporains.. N’OSENT PAS LE FAIRE.
J’aimeJ’aime