Version imprimable de Subsister de Nicolas Gey
Nicolas Gey
Subsister
L’Inventaire, automne 2022
Merci à Amélie, à qui
cette réflexion doit beaucoup.
Comme Aurélien Berlan le confie au lecteur, son dernier ouvrage, intitulé Terre et Liberté, est né d’une dizaine d’années de lectures, d’analyses et d’expériences (personnelles et collectives) touchant aux relations périlleuses qu’entretiennent quête d’autonomie et fantasme de délivrance. La réflexion, méticuleuse et claire, possède en outre le mérite de ne pas éluder la question de l’énergie dont tout effort d’autonomie dépend effectivement. Une fois ramenée dans le giron de la politique, la question de l’énergie rappelle que nous ne pouvons nous contenter d’espérer une juste redistribution des fruits de la croissance industrielle (qui, comme l’avait compris Ivan Illich, concentre par essence le pouvoir) : il faudrait, ici et maintenant, distribuer plus équitablement les ressources naturelles et le travail, travail entendu au sens physique de dépense utile d’énergie.
On regrettera toutefois que l’analyse s’arrête en chemin, dans son dernier tiers, lorsqu’elle délaisse subrepticement le postulat matérialiste sur lequel elle entendait se fonder. À mesure que la réflexion sur l’autonomie prend un tour plus idéel, le propos se fait plus volontariste, sinon incantatoire. Ainsi, lorsqu’elle s’applique à distinguer entre une conception survivaliste de la situation socio-économique et une conception moins libérale, qualifiée de « subsistantialiste », cette réflexion sacrifie finalement à l’impératif militant qui enjoint à chacun de conclure toute prise de position sur une note positive :
Dès lors que l’on adopte la perspective de la subsistance, écrit Aurélien Berlan, l’hypothèse que le supermarché global s’effondre perd sa dimension apocalyptique : ce ne sera pas la fin du monde, mais seulement la fin d’un monde, celui que les puissants ont construit dans leur propre intérêt. (1)
Qui doit-il subsister ?
L’idée d’apocalypse est-elle ici rejetée pour de bonnes raisons ? Au fond, cette idée caractérise assez bien la situation de délabrement écologique, social, économique, culturel et politique dont nous sommes à la fois victimes, acteurs et témoins. Encore faut-il préciser, avec Günther Anders, que cette apocalypse n’a pas de « royaume ». Dans cette catastrophe sans fin, nulle révélation, nulle justice immanente, nul ordre moral immuable, nulle nature qui « reprendrait ses droits (2) ». L’apocalypse en cause est une déconfiture à la fois générale et carnavalesque, inique et absurde, vécue de manières fort différentes selon la place sociale, le lieu et les conditions d’existence.
Or l’idée de subsistance, lorsqu’on l’associe à celle d’effondrement, ne peut manquer de se charger d’une autre signification du verbe « subsister », qui désigne aussi, lorsqu’il est appliqué aux choses, le fait de continuer d’exister, après élimination des autres éléments, ou malgré le temps. Distinguer strictement entre clients du supermarché global et subsistantialistes, affirmer que ceux-là auraient plus à craindre d’un effondrement économique que ceux-ci, trahit une tentation de discriminer entre des groupes humains en vertu d’un critère non plus politique et social mais bien religieux. Comme si la simple volonté de subvenir à ses besoins fournissait le nouveau critère permettant de rejouer le mythe de l’Apocalypse johannienne, foncièrement occupée à discriminer entre élus et damnés.
Contre cette tentation, il faut évidemment garder à l’esprit que nul n’est pur. Le long du fleuve Congo, par exemple, ce ne sont pas seulement les monocultures de palmiers à huile qui détruisent l’un des milieux naturels les plus riches de la planète ; ce sont aussi de populeuses familles de paysans qui défrichent la forêt primaire pour les besoins d’une agriculture de subsistance.
D’autre part, nombre de sociétés paysannes existantes ne vivent-elles déjà une situation apocalyptique ? Pauvres d’entre les pauvres, les affamés (dont une majorité sont paysans) parviendraient-ils de facto à pourvoir à leurs besoins s’ils venaient, par exemple, à être tout à fait privés d’huiles, de sucres et de céréales industriels achetés sur les marchés mondiaux ? Et s’ils étaient tout à fait privés de pétrole pour actionner groupes électrogènes, tronçonneuses, mobylettes, batteuses et pompes tandis que sévit la sécheresse ? Et comment croire que, dans ces conditions, le reflux dans les campagnes d’une population partie travailler dans les bidonvilles de la métropole serait toujours une aubaine pour les paysans restés à la ferme ?
Que nous indique ensuite que les « subsistantialistes » des nations riches se situent bien du même côté de la fin dudit « supermarché global » ? Qui d’entre nous pourrait se targuer de produire le minimum pour se sustenter ? Qui produit son blé, son seigle, son orge, son sarrasin et son maïs ; qui produit ses farines, lentilles et fruits secs, pâtes, sucres, plantes à huiles (lin, tournesol, colza, olives, noix, etc.), graisses animales (saindoux, suif, graisse de canard ou d’oie) et boissons alcooliques ? Qui parvient seulement à vivre sans voiture ni Internet dans les campagnes françaises de 2022, vidées non seulement de leurs paysans, mais aussi de leurs artisans et de leurs petits commerces ? Autrement dit, qui peut prétendre subvenir à ses besoins, vivre substantiellement de sa production ? S’il existe quelques personnes ou communautés d’Europe de l’Ouest qui y parviennent, je serais ravi, sinon de les rencontrer, du moins d’entendre de quelle manière elles s’y prennent. De ce point de vue, il n’est pas nécessaire de partager les orientations politiques du courant survivaliste pour souscrire au tragique de ses analyses.
Aurélien Berlan établit donc un parallèle discutable entre les ZAD et les zapatistes du Chiapas. Bien que les expérimentations « subsistantialistes » des ZAD d’Europe et la résistance organisée dans le Chiapas (3) aient en commun de viser une autonomie qui n’évacuerait ni le devoir d’équité sociale ni ses conditions physiques, terrestres et vivantes, le parallèle devient fallacieux lorsqu’on songe que les indigènes du Chiapas n’ont à notre connaissance jamais cessé d’être paysans (depuis qu’ils le sont), tandis que les expérimentations menées sur le sol européen sont depuis longtemps déjà le fait d’enfants du pétrole, d’individus et de groupes qui n’ont pas seulement à défendre une autonomie en partie héritée, pas seulement à la reconquérir même : ils doivent, paradoxalement, la reconquérir contre leur propre pouvoir de consommateurs des nations riches, contre leurs habitudes d’enfants peu rompus à l’effort et à la souffrance physique comme aux impératifs du travail collectif, peu frustrés, peu affectés par les aléas climatiques, indemnes enfin de l’expérience de la guerre.
Cette reconquête de l’autonomie implique au demeurant qu’il soit toujours possible d’effectuer, mais en sens inverse, le trajet qui mène de l’autonomie à l’hétéronomie, de l’état de chasseur-cueilleur (4) ou de paysan à celui de membre actif d’une société industrielle. À l’heure où l’informatique nous accoutume à un monde virtuellement débarrassé d’entropie (la fonction « annuler » des logiciels) n’est-ce pas reproduire, quoique pour notre compte, le refus historique de la deuxième loi de la thermodynamique qu’Aurélien Berlan relève à juste titre chez les économistes ? C’est peu dire que les phénomènes irréversibles sont légion : le chaos climatique a commencé ; les déserts arides s’étendent partout où ils existent, les sols s’effondrent sur les nappes phréatiques asséchées ; les forêts tempérées d’Europe (qui commençaient à peine à se remettre de l’apogée paysan) dépérissent massivement lorsqu’elles ne font pas l’objet de coupes rases pour l’exportation ; la quantité et la qualité des terres arables baissent inexorablement ; tout comme les rendements agricoles ; les populations de gibiers (qui, elles aussi, commençaient à peine à se remettre de l’apogée paysan) sont relictuelles ; les meilleurs gisements d’énergie fossile et de minerais sont déjà exploités ; les déchets nucléaires s’accumulent, le capital industriel poursuit sa concentration mais le capital productif et les « infrastructures » (routes, réseaux d’adduction d’eau et d’électricité, etc.) ne peuvent plus être entretenus sans création d’une dette insolvable, tandis que la démographie humaine explose : il n’y a jamais eu sur Terre autant d’humains en âge d’avoir des enfants, etc.
Il n’est évidemment pas question de minorer ici l’importance décisive de la lutte qu’États et industriels mènent de conserve depuis plus d’un siècle contre les dernières communautés autonomes (5). Cependant, cette histoire de domination ne suffit à expliquer pourquoi tant d’individus (voire des communautés entières) se rendent en ville pour s’y vendre sur le « marché du travail ». Comme l’ont bien montré Laurence Roudart et Marcel Mazoyer (6), la densité de population et la productivité des terres elles-mêmes restent des facteurs non négligeables dans l’évolution des modèles agricoles comme dans les mouvements d’exode. Ainsi, depuis plusieurs décennies, la forte densité de population des communautés anabaptistes de Pennsylvanie pousse un grand nombre de jeunes à quitter la ferme de leurs parents pour devenir artisans ou employés, ou pour coloniser de nouveaux territoires américains.
Les expériences « subsistantialistes » ne sauraient ignorer ce phénomène, puisqu’elles s’établissent généralement dans les régions agricoles les moins peuplées d’Europe, celles qui subirent l’exode paysan le plus massif entre les années 1860 (7) et 1970. Celles aussi qui possèdent les conditions pédo-climatiques les moins favorables à la production alimentaire (sécheresse, sols excessivement acides ou basiques, déficit d’humus voire de terre, déclivité, manque d’ensoleillement, difficulté d’accès, gels tardifs, etc.). S’il nous est encore possible d’investir, ici ou là, des espaces assez peu prisés (avant que l’économie touristique n’entreprenne de « valoriser » les lieux) et relativement peu peuplés d’Europe, c’est souvent parce que leur valeur vivrière est faible, voire très faible. Quant au bois qui nous chauffe, permet de restaurer une charpente ou alimente nos fourneaux, il provient précisément d’un siècle de cette déprise agricole que nous déplorons par ailleurs.
Quelles sont, pour un œil extérieur du moins, les pratiques qui caractérisent les expérimentations « subsistantialistes » les plus abouties en France ? Elles consistent à aménager, éventuellement dans le cadre d’un « collectif », un bâtiment à la campagne. On y bricole des toilettes sèches, des panneaux solaires thermiques et un four à pain, on entretient un potager, un verger, un rucher, on coupe du bois de chauffage, on élève des volailles (et plus rarement des lapins), quelques brebis ou chèvres, etc. Certes, ce n’est pas rien, comme nous le rappellent quotidiennement les efforts et la persévérance consentis : à lui seul, ce travail a largement de quoi nous accaparer. Mais cela correspond peu ou prou (panneaux solaires mis à part) à l’économie domestique de nombre de salariés des campagnes françaises jusque dans les années 1990.
Engagés dans ce mouvement de réappropriation, d’autant plus grisant qu’on a grandi dans la dépendance générale d’une métropole, on pourrait espérer qu’il s’agît seulement d’une étape, transitoire, vers une autonomie plus grande, plus substantielle, plus politique.
La chair rouge de la tomate
Je crois au contraire que cette idée, utile pour ne pas s’abîmer dans le désespoir, achoppe néanmoins sur un écueil infranchissable : c’est l’impossibilité constatée de produire par nous-mêmes non seulement une grande quantité de nourriture, mais une quantité suffisante de calories. Pour exister, conserver son autonomie et perdurer, toute communauté ne doit pas seulement faire son jardin (un secteur économique lucratif, du reste) ; elle doit d’abord trouver les moyens à la fois politiques et techniques de récolter davantage d’énergie qu’elle n’en dépense pour la récolter. Or, de la lecture de quatre essais assez récents (Terre et Liberté, d’Aurélien Berlan, La Fin de la mégamachine, de Fabian Scheidler, La Liberté dans un monde fragile, de José Ardillo et Le Sens des limites, de Renaud Garcia), je sors avec le sentiment que la réflexion libertaire (que rien ne distingue, sur ce point, de la propagande) est loin d’accorder aux difficultés de la production alimentaire la place qu’elles méritent. José Ardillo écrit ainsi :
On sait [sic] que, de manière globale, non seulement aucune augmentation de la production alimentaire n’a eu lieu, mais qu’au contraire chaque augmentation minime du rendement des récoltes ne s’est faite qu’au prix d’énormes pertes d’énergie, d’eau et de sol fertile. (8)
Si la dénonciation des effets dévastateurs de la mécanisation, de l’aliénation des agriculteurs, de l’irrigation par pompage, des engrais de synthèse et des pesticides est parfaitement légitime, il est en revanche assez malhonnête d’en déduire que cette agriculture industrielle n’aurait obtenu que des « résultats minimes ». Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1990, les rendements céréaliers moyens ont bel et bien été multipliés par 4 en France et par 3 en moyenne dans le monde. Puisque la surface cultivée totale est restée à peu près constante (la surface de champs urbanisés étant pour l’instant « compensée » par la conversion des pâturages et le défrichement accéléré des ultimes forêts primaires), la production a donc été multipliée par trois et la population mondiale, dont la frange la plus riche s’est mise à consommer de plus en plus de viande (9), par 2,5 (passant de 2,4 à 6 milliards d’individus). Depuis les années 1990, effectivement, les rendements du blé plafonnent et paraissent même, depuis 2016, amorcer leur déclin.
Ce qui n’empêche pas la productivité agricole de continuer sa course au « progrès » : à mesure que se généralise la robotisation (10) de l’agriculture et de « l’élevage », un nombre toujours réduit de travailleurs suffit à produire une quantité constante de nourriture. Ce qui participe, avec les subventions, au coût modique des aliments les plus nutritifs que nous consommons (11). Pourquoi minorer ce phénomène ? En France, l’apogée de la population paysanne eut lieu au moment où Célestin Gérard inventait la batteuse mobile, dans le courant des années 1860 (12). Plus de 26 millions de personnes étaient alors paysannes, soit 70 % de la population nationale. Avant l’apparition de la batteuse mobile, il fallait donc le travail de trois paysans pour nourrir un artisan ou un instituteur. Aujourd’hui, un seul céréaliculteur de la Beauce (la plus vaste région de production de blé tendre d’Europe) peut produire plus de 100 tonnes de blé par an : suffisamment pour nourrir 250 végétariens.
Pour les états, démographie et production d’énergie alimentaire constituent deux préoccupations stratégiques (13). En France, l’importance politique du blé tendre est telle que l’aire d’origine de la culture devenue « nationale » (Paris et une quinzaine de départements alentour) recoupe largement celle des cultures de cette céréale (aire qu’on qualifie parfois de « plaine française ») : s’il est légitime de décrier le calcul des aides que la politique agricole commune indexe à la surface de production, il faut s’exprimer (ce qu’on fait moins) sur la dimension énergétique de ces aides, dont le calcul dépend aussi de la valeur calorique des aliments produits. De sorte que le maraîchage et l’arboriculture sont nettement moins subventionnés que la production d’oléo-protéagineux (comme les appellent les agronomes). Un kilo de tomate, du fait de la main-d’œuvre nécessaire pour sa culture et sa récolte, dépasse souvent le prix de 1 kg de blé, mais sa valeur politique est à peu près nulle : on n’a jamais fait de révolution pour cause de pénurie de tomates.
Or ce sont précisément les productions agricoles les plus riches en calories et en travail, fût-il mécanique, que les expériences subsistantialistes tendent à ajourner (14). Et pour cause : acheter des céréales, des légumineuses, des sucres, des huiles issues de la production mécanisée et subventionnée revient à acheter chaque jour, pour moins de 2 euros le kilo, une quantité de travail que nous refuserions de fournir à ce prix. Pour fixer les idées : l’équivalent d’une journée de travail de cinq à sept heures (15). Payé au smic de 2021, le coût du travail nécessaire pour produire 1 kg de blé sans tracteur, moissonneuse-batteuse ni subvention serait donc compris entre 50 et 70 euros. Dans ces conditions, qui d’entre nous, s’il ne possédait une rente d’au moins 1500 euros par mois (ce qui le rangerait indiscutablement du côté des puissants), pourrait encore acheter quotidiennement son kilo de farine équitablement subsistantialiste (ou son équivalent énergétique d’environ 2 500 kcal) ?
Lorsque l’étendue et la fertilité des terres céréalières décline en même temps que croît la population (la France, dont la démographie est dite « stabilisée », doit tout de même trouver à nourrir l’équivalent d’une métropole lyonnaise supplémentaire tous les quatre ans, tandis qu’elle perdrait tous les six ans une surface de terres cultivables équivalente au département du Rhône), le pouvoir n’a guère d’autre choix que de conserver, en le renforçant sans cesse, le système d’approvisionnement et de production de calories alimentaires qui constitue en définitive la base de toute son organisation politico-économique. Qu’on le veuille ou non, cette organisation est donc aussi la nôtre (bien qu’elle constitue un obstacle considérable à la mise en place d’une production autonome, pérenne et substantielle d’énergie alimentaire).
Reste l’opinion selon laquelle une « petite » agriculture, bricolante, mécanisée mais pas trop, pourrait parvenir à la rentabilité. Qui sait ? Tout dépend néanmoins de la définition que nous voulons bien donner à cette rentabilité. Pour y voir plus clair, évaluons à grands traits le rôle énergétique et politique de deux engins indispensables à toute « petite » production de céréales bio (16) : le tracteur et la moissonneuse-batteuse. Pour un passage de labour, un petit tracteur (60 ch) consomme au minimum 20 litres d’essence par hectare, soit l’équivalent de 172 000 kcal. Les moissonneuses-batteuses consomment quant à elles de 10 à 15 litres d’essence par hectare de céréales, légumineuses ou oléagineux récolté. Soit 85 000 à 130 000 kcal de carburant. Sans même parler du semis, de l’amendement et du désherbage, le passage d’un tracteur et d’une moissonneuse-batteuse consomme donc (en pétrole) l’équivalent énergétique de 90 quintaux de blé par hectare cultivé. Ces rendements demeurent exceptionnels en agriculture dite « conventionnelle » : ils sont inaccessibles dans le cadre d’une petite production familiale (à moins de sacrifier la production totale au seul rendement, en irriguant ou en concentrant fumier et compost d’une année sur une parcelle de moins de 100 m2). Jusqu’à preuve du contraire, et dans les conditions qui sont les nôtres (et qui n’ont guère de raison de devenir plus favorables), on peut donc affirmer qu’il n’existe, en Occident, aucun modèle agricole économiquement viable susceptible de récolter davantage d’énergie qu’il n’en consomme pour la produire (17).
Si le fait passe inaperçu, c’est que la production pétrolière globale est à son apogée, désormais par la grâce de subventions qualifiées « d’assouplissements quantitatifs ». Mais si l’on veut bien croire au déclin imminent des quantités d’énergie disponibles (18) (et quelles qu’en soient les raisons : géostratégiques, politiques, financières, naturelles, etc.), industriels et subsistantialistes ne pourront se détourner indéfiniment de la préoccupation centrale de toute communauté autonome : comment produire davantage de calories alimentaires qu’on en dépense, par le travail, pour les produire ? Comment produire au minimum, c’est-à-dire les plus mauvaises années, 400 kg de céréales par personne ? Et si l’on prend en compte les vieillards, les invalides et les enfants, l’alimentation des animaux d’élevage et la part de semence (entre 100 et 200 kg par hectare), une communauté véritablement subsistantialiste exigerait donc de produire, au bas mot, 1 tonne de céréales par travailleur et par an (19). Sans quoi l’utopie n’échouerait pas seulement à nourrir tout le monde, elle serait certaine de ne nourrir personne.
Mais comment se lancer dans cette production autonome de blé, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de tournesol, de colza ou de lin lorsque notre monde n’est plus paysan depuis plus de quarante ans et que l’énergie alimentaire ne coûte pratiquement rien à l’achat ? Comment acheter de coûteuses terres céréalières lorsqu’on n’escompte pas en dégager un revenu, mais seulement des récoltes (20) ? Question plus épineuse encore : comment s’y prendre lorsqu’on a (choisi d’avoir) des enfants ?
Pour nous subsistantialistes, il ne suffit pas de suggérer qu’on pourrait toujours, le moment venu, se déplacer et labourer avec un animal de trait (21), battre les céréales au fléau, trier le grain avec un tarare, remettre en service des moulins à vent ou à eau, entretenir nous-mêmes les sentiers, les conduites d’eau, les routes pavées et les entrepôts, que sais-je ? N’oublions pas de poser ces questions, en apparence naïves : Qui fait quoi, et surtout quand ? En d’autres termes, qui s’y lance maintenant, avant les autres, au risque de l’épuisement moral et physique ? Qui accepte de commercer avec l’ensemble d’une population directement et indirectement mécanisée et subventionnée ? Qui accepte, en somme, de troquer l’or contre la pacotille ?
Mais si, comme le craignent « collapsologues » et survivalistes, des pénuries et des ruptures d’approvisionnement devaient finalement survenir (22), la menace qui pèserait sur les expérimentations concluantes d’autonomie serait sans doute plus grande encore. Qui fournirait la semence à ceux qui en manquent ? Qui serait en mesure de produire des surplus ? Où trouver les précieux hectares de terre ? Et les sources d’amendement (23) ? Et les petites machines de moisson et de battage (24) ? Et les animaux de traits dressés ? Ne perdons pas de vue qu’en cas de fin de ce monde-ci, privés de véhicules motorisés, de motoculteurs, de tronçonneuses et des machines électriques (machines à coudre, perceuses, machines à laver, scies circulaires, meuleuses, postes à souder, etc.), privés d’assurances et de Sécurité sociale, il nous faudrait de surcroît remplacer le travail mécanique des engins par celui de notre corps (dont le cerveau, qui consomme à lui seul 20 % à 25 % de l’énergie alimentaire), et donc ingurgiter davantage de céréales, de sucres et d’huiles. Et sans doute aussi d’alcool.
Partage des tâches & partage du travail
Dans La Fin de la mégamachine, c’est avec une certaine désinvolture que Fabian Scheidler envisage à son tour la fin de la production industrielle de nourriture. Comme s’il souhaitait clore la question avant de l’avoir posée, il invoque, après tant d’autres (25), une étude consacrée d’Olivier de Schutter censée démontrer que la généralisation des techniques « agroécologiques » pourrait nourrir une population mondiale de près de 10 milliards d’individus. Sans même douter des compétences du juriste Olivier de Schutter en matière d’agriculture et d’agronomie, je me contenterai d’inviter chacun à lire ce fameux rapport (26) à la lumière des remarques exprimées dans cet article. Il ne s’agit pas ici de nier que quelques techniques agricoles sont susceptibles d’intensifier çà et là la production alimentaire, mais de dénoncer fermement l’imposture qui consiste à généraliser ce constat. Jusqu’à preuve du contraire, toutes les expérimentations « permacoles » (27) et « agroécologiques » non mécanisées des régions tempérées ont échoué à produire non seulement des légumes sur des terres généreusement amendées et paillées (souvent avec fumier et paille du commerce), mais suffisamment de calories pour nourrir, au minimum, les agriculteurs eux-mêmes.
Dans certains cas, comme au mas de Beaulieu de feu Pierre Rabhi, l’expérimentation, sur un hectare, est loin d’égaler la modeste production maraîchère d’un jardin ouvrier (28). Ailleurs, à la Ferme du Bec-Hellouin (29), Perrine et Charles Hervé-Gruyer renouvellent quant à eux les trouvailles de Bouvard et Pécuchet (30) en terre normande. Là-bas, les cultures nourricières cèdent systématiquement le pas aux productions à forte valeur ajoutée, jusqu’à délaisser la pomme de terre ! Les amendements proviennent de haras voisins ; les résultats publiés sont avant tout financiers, proviennent pour bonne part de formations, et lorsque les volumes de production de certains fruits ou légumes sont annoncés, il n’est jamais question de calories. Or la Ferme Potemkine du Bec-Hellouin est censée apporter sa contribution (sinon la solution) au problème de l’autonomie alimentaire (individuelle, communale, régionale, nationale, etc.). En dépit de l’évidence, une succession de rapports de l’Inra-AgroParisTech conclut toutefois au succès de l’entreprise agroécologique (31).
À dire vrai, il n’est pas très difficile de comprendre pourquoi l’administration nationale a tout intérêt à entretenir, auprès de ses salariés du moins, l’illusion d’une agriculture « postpétrole », « citoyenne » et hautement productive. En laissant croire que quelques bacs de maraîchage collectivisé pourraient participer à l’autonomie alimentaire de ses « territoires », l’État justifie la poursuite de l’artificialisation des prés et des champs. En d’autres termes, quelques mètres carrés de bacs divertissent de l’extension indéfinie des hectares de ZAC (32).
Une fois entendu qu’un potager ne nourrit pas (33), attardons-nous un peu sur les implications politiques de ce constat. Du travail de la terre au semis, du semis à la moisson, de la moisson au battage, du battage à la mouture (34), la production d’énergie est à la fois aléatoire (toutes les moissons ne sont pas fastes, tant s’en faut), éreintante, fastidieuse, exigeante en savoir-faire et impérative : ainsi le temps des labours, des moissons et du battage, dicté par les saisons, ne saurait-il être effectué seul. Collectifs, ces travaux imposent aussi une cadence (35) qui laisse bien peu de temps aux débats. Chacun doit avant tout comprendre quelle est sa place, la place où il participe le plus efficacement à la production elle-même. Le besoin d’efficacité relègue alors, provisoirement, le devoir d’équité.
Passés certains seuils (temps et surface disponibles, densité de population, capacité nourricière d’une terre, complexité de l’organisation technique d’une communauté, proportion d’individus en mesure de fournir un travail important), recherche d’équité et recherche d’autonomie semblent bien entrer en conflit. Passés certains seuils, il faut choisir entre partage des tâches et partage du travail, voire entre justice et liberté. S’engager dans la production collective de céréales et d’oléagineux (avant de cultiver des plantes textiles), c’est-à-dire produire annuellement plus de 10 tonnes de céréales et 1 tonne d’oléagineux si l’on est dix et qu’on ne compte pas produire de surplus pour les citadins (36), exige de ses membres qu’ils acceptent comme nécessaires des tâches et des efforts qu’ils ont tout intérêt à ne pas concevoir comme tels. Des types de tâches, des efforts inconnus, et des rythmes, et d’inévitables subordinations qui, dans l’ignorance du travail exigé et dans l’habitude des prix bas, auraient tout lieu de faire naître des revendications politiques entre personnes, entre sexes, voire entre générations. D’autant qu’il est encore possible de quitter la communauté, toucher une aide sociale ou un revenu beaucoup moins coûteux en efforts.
Ce que nombre de « permaculteurs » (plus ou moins survivalistes) et « d’agroécologistes » ne perçoivent pas lorsqu’ils tentent l’expérience de « l’autonomie » (mais ils finissent invariablement par délaisser l’agriculture au profit d’activités plus lucratives, comme la formation, l’accueil de touristes, les « soins alternatifs », etc.), c’est le caractère systémique d’une organisation paysanne. Les dimensions d’héritage culturel, de normes, de devoirs, d’effort et de temps sont généralement refoulées ou fantasmées plutôt qu’appréhendées dans leur complexité et leurs limites. S’il est évidemment impossible de répondre à tous ses besoins (de la mine à la forge, de la carrière au four à chaux, des champs de lin aux métiers à tisser, etc.), il l’est presque autant, sous nos latitudes surpeuplées (37), de répondre à ses besoins les plus vitaux, sans se soumettre aux lois de la physique bien sûr, mais aussi à l’autorité d’un groupe, sinon à l’un.e de ses représentant.e.s. Qui serait prêt à accepter, ponctuellement du moins, que certains endossent l’autorité, dans quelles conditions et sous quelle forme ?
Toute culture paysanne procède d’une œuvre collective : aucune d’entre elles n’est « naturelle » ou innée. Or les degrés et les types d’autorité que nous sommes capables d’exercer ou d’observer procèdent pour bonne part de notre éducation. Cela étant, viser une véritable autonomie alimentaire sans rien céder d’exigences de justice héritées d’un monde d’abondance énergétique revient à évoquer le partage de l’énergie avant de l’avoir produite. C’est ce qu’on appelle placer la charrue avant les bœufs.
Car l’espace exploité, et le temps dont on dispose, et nos forces, ne sont pas infinis. Autrement dit, rien n’indique qu’une autonomie digne de ce nom puisse s’accommoder d’une répartition équitable et spontanée du travail, comme d’une répartition de l’effort et des tâches. Si l’on doit désherber, qui s’occupera des animaux ? Si meubles et outils ne durent pas, aurons-nous le temps d’en fabriquer de nouveaux ? Qui préparera à manger si certains doivent charrier des poutres, dégager des embâcles dans un ruisseau ou restaurer un pan de toit arraché par une tempête ? Qui fait les moissons, qui sort le fumier, qui dresse les chevaux si d’autres doivent réparer en catastrophe une adduction d’eau ? Qui s’occupe des enfants s’il faut redresser les clôtures défoncées par des chutes d’arbres ? Qui déplacera des massacans de 300 kg pour édifier les fondations d’une muraille qui vient de s’écrouler sur le chemin ? Peut-on à la fois élaborer des solutions techniques low tech et laisser chacun en user en consommateur, comme il a été habitué à le faire avec les objets techniques conçus par des ingénieurs ? Chacun peut-il apprendre toutes les techniques, être éduqué dès le plus jeune âge à toutes les dispositions d’esprit nécessaires ? Apprendre à la fois à résoudre les problèmes techniques et les difficultés politiques qui ne cessent de surgir ? Participer à toutes les tâches les plus épuisantes et toutes les tâches les plus répétitives ? Effectuer tous les travaux les plus périlleux et tous les travaux les plus indispensables ? Bref, est-ce que chacun peut, en une vie, assimiler et endosser tous les savoir-faire d’une société aussi complexe ? Réciproquement, une communauté peut-elle laisser à chacun le loisir d’apprendre à son rythme, par lui-même, dans une démarche « naturelle » et non violente, les savoirs nécessaires au bon accomplissement des tâches qui lui agréent ?
Pensée de la sorte, l’existence autonome ne saurait faire longtemps l’économie des questions honnies de l’efficacité d’une part, de l’autorité d’autre part, mais aussi de celle de la répartition générationnelle et sexuelle des tâches. L’idée n’est ni nouvelle ni en vogue, mais je crois qu’elle est inévitable dès lors qu’on essaie, effectivement, de subvenir à ses besoins. Dans les sociétés patriarcales, les places dévolues à l’homme, à la femme et à l’enfant ne sont pas seulement le résultat d’une domination. Le patriarcat constitue aussi une astuce des sociétés paysannes des climats tempérés pour rétribuer symboliquement les tâches que seules certaines catégories de personnes sont en mesure d’effectuer. Ainsi Aurélien Berlan rappelle-t-il que le lavage de voiture n’est pas honteux aux hommes (alors même que le lavage est une tâche associée aux femmes) parce qu’il est lavage de voiture. C’est juste, mais incomplet. Il faudrait en outre préciser que nombre de tâches ont traditionnellement été attribuées à certaines catégories parce que d’autres ne pouvaient les effectuer (essentiellement parce qu’ils n’en ont pas, ou pas encore, ou plus les moyens, comme le fait de ne pas pouvoir porter d’enfant ou de ne pas pouvoir travailler normalement durant la grossesse).
À rebours de convictions répandues parmi les plus citadins d’entre nous, et non sans paradoxe, tout porte à croire que femmes, enfants et invalides seraient les grands perdants d’une confusion entre répartition équitable du travail (au sens physique) et répartition équitable des tâches. Privés du travail mécanique des tracteurs et des batteuses, les membres des catégories traditionnellement dominées en Europe devraient finalement, s’ils refusaient méthodiquement toute répartition sexuelle et générationnelle des tâches, assumer la plus grande augmentation de leur charge de travail.
De ce point de vue, il n’est pas si surprenant d’apprendre que la réglementation du travail des enfants succède historiquement à l’exploitation du charbon ; tout comme la critique du machisme accompagne, en Occident, l’essor du machinisme. Dans le courant du xixe siècle, en Europe, les revendications féministes et anarchistes apparaissent au moment où commence à se creuser l’écart entre l’espérance de vie des hommes et des femmes, écart qui succède aussi à la généralisation des batteuses mobiles et des tracteurs.
En définitive, si les formes d’organisations sociales et politiques ne sont pas déterminées par leurs conditions physiques, économiques ou culturelles, elles n’en demeurent pas moins limitées, et d’autant plus que ces conditions générales sont appelées à se dégrader. Cela étant dit, quelles exigences politiques et techniques pouvons-nous raisonnablement nous donner ? Reste-t-il des utopies au sein desquelles les agriculteurs ne font pas systématiquement office de « variable d’ajustement » ? Voici les questions auxquelles je ne pouvais même espérer répondre sans excéder le cadre de cet article.
Notes
1. Aurélien Berlan, Terre et Liberté. La quête d’autonomie contre le fantasme de la délivrance, La Lenteur, 2021.
2. Pour une analyse historique de l’imaginaire apocalyptique, voir Lucian Boia, La Fin du monde, une histoire sans fin, La Découverte, 1989.
3. Aurélien Berlan, ouvr. cité, p. 148-149.
4. Dans l’état actuel des connaissances, les archéologues supposent que la population européenne de chasseurs-cueilleurs n’a jamais dépassé 5 000 ou 6 000 individus. La vallée d’Auvergne où je réside est donc plus peuplée que l’Europe entière avant sa colonisation par des communautés paysannes.
5. Karl Polanyi, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Éditions Gallimard, 1983 [The Great Transformation, 1944] ; Fabian Scheidler, La fin de la mégamachine. Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement, Éditions du Seuil, 2020.
6. Laurence Roudart et Marcel Mazoyer, Histoire des agricultures du monde, du néolithique à la crise contemporaine. Éditions du Seuil, 1997.
7. Dans le courant du XIXe siècle, la terre (mais aussi le bois et le gibier) commençait à manquer, comme en témoignent les dernières terrasses construites jusque sur les versants nord des massifs montagneux (Alpes, Auvergne, Pyrénées, Cévennes). À force de défrichements agricoles (mais aussi de charbonnages et de chantiers navals), la forêt atteignit son plus bas historique au début du XIXe siècle, avec un taux de boisement d’environ 12 %. À la même époque, et ce malgré l’éradication des grands carnivores (ours, loups, lynx), ongulés sauvages et sangliers étaient au bord de l’extinction en Europe. À la fin du XIXe siècle, le sanglier avait pratiquement disparu de France et le cerf élaphe d’Europe de l’Ouest. Le bison d’Europe avait déjà disparu de France au VIIIe siècle, de Suisse au XIe siècle, d’Allemagne au XVIIe siècle, de Transylvanie au XVIIe siècle et de Pologne dans les années 1920. C’est en Pologne aussi, dans la forêt de Jaktorow, qu’est mort le dernier aurochs, en 1627.
8. José Ardillo, La Liberté dans un monde fragile, écologie et pensée libertaire, éditions L’Échappée, 2018, p. 39.
9. Pour produire industriellement 1 kg de bœuf, 7 kg de céréales sont nécessaires, 4 pour 1 kg de porc, 2 pour 1 kg de poulet. Ne nous leurrons pas : il en faut davantage pour produire du porc ou du poulet de manière artisanale. Tandis que les poulets de batterie sont abattus à six semaines, un poulet de basse-cour du même âge est à peine plus gros qu’une caille. Ce qui explique largement la (très) faible consommation de viande des paysans.
10. L’Atelier paysan, Reprendre la terre aux machines. Le Seuil, 2021.
11. Un coût qui n’atteint tout de même pas l’ordre de prix que Renaud Garcia évoque distraitement dans l’un de ses ouvrages : « Pour donner un exemple schématique [de la baisse tendancielle de la valeur des biens produits par l’industrie], dans le cadre de besoins alimentaires égaux, si aujourd’hui cinq tonnes de céréales représentent une valeur de dix euros, alors dans dix ans ce seront quinze tonnes de céréales qui vaudront dix euros ». Renaud Garcia Le Sens des limites, contre l’abstraction capitaliste, L’Échappée, 2018.
12. À la même époque, en Amérique du Nord, la moissonneuse-batteuse inventée par Hiram Moore en 1834 était déjà largement utilisée dans les grandes plaines céréalières. Les historiens s’accordent à y déceler la cause principale de l’effondrement du cours du blé en France, effondrement lui-même responsable d’un important exode paysan dans les années 1860-1870.
13. Sébastien Abis, Géopolitique du blé, un produit vital pour la sécurité mondiale, Armand Colin, 2015.
14. Il est frappant de constater que, à notre connaissance, les collaborateurs de L’Atelier paysan ne fournissent que des plans de batteuse à semence potagère. Où trouver des plans de batteuse motorisée, sans parler d’une hypothétique batteuse manuelle ?
15. Cette estimation m’est propre, et mérite sans doute discussion. Je suis parti du principe qu’il fallait en moyenne 5 à 10 m2 de terre pour fournir 1 kg de blé tendre dans des conditions « subsistantialistes », sans tracteur ni engrais de synthèse. Le calcul consiste simplement à additionner le temps passé à labourer (ou bêcher) cette surface de terre, avant de la semer et d’enterrer le semis (afin qu’il ne soit pas détruit par des étourneaux, des corneilles ou des pies), puis de la désherber (des gaillet, vulpin, folle avoine, rumex, chénopode, renouée, amarante et chardon, entre autres) et de l’amender, avant de la moissonner, d’en transporter les gerbes jusqu’à l’aire de battage, de battre les gerbes, d’en vanner le grain, de le moudre puis de bluter la mouture. Sans compter le travail de cuisine et de boulangerie, ni le temps passé à récolter du bois pour la cuisson.
16. Les amendements organiques réduisent pour partie la dépendance de l’agriculture « biologique » aux ressources fossiles. Dans le même temps, cette agriculture sans pesticide recourt davantage aux procédés mécaniques de lutte contre les adventices (fauches, déchaumages et binages, entre autres). Par conséquent, le tracteur passe plus fréquemment sur une culture « bio » que sur une culture dite « conventionnelle ».
17. Malgré les idées reçues au sujet des communautés amish de Pennsylvanie, rares sont les familles qui continuent d’utiliser la traction animale pour le labour. La plupart utilisent depuis longtemps déjà de petits tracteurs diesel.
18. Hortense Chauvin et Matthieu Auzanneau, Pétrole : le déclin est proche. Éditions du Seuil, 2021.
19. Ce qui correspond à la productivité maximale d’un paysan dénué ou privé de mécanisation. Voir Laurence Roudart et Marcel Mazoyer, Histoire des agricultures du monde, du néolithique à la crise contemporaine. Éditions du Seuil, 1997.
20. La génération d’agriculteurs qui travaillaient sur une SAU de moins de 50 ha finit de partir à la retraite. Il est d’ores et déjà rare de trouver à la vente des propriétés agricoles qui soient à la fois susceptibles de nourrir et accessibles financièrement. Dans la Beauce, où l’hectare coûte plus de 10 000 euros, les exploitations à vendre font rarement moins de 100 hectares. Seul ou dans le cadre d’un groupement d’achat, il faut par conséquent rassembler au minimum 1 million d’euros pour y acheter des champs. La situation n’est pas forcément meilleure dans des régions supposément « reculées » : dans le département du Cantal, l’hectare agricole coûte en moyenne 12 000 euros.
21. Dans les régions montagneuses, l’utilisation du cheval de trait fut rendue possible par l’exode rural. Ce sont les terres libérées par la baisse de la population rurale qui a libéré l’espace pour l’élevage d’animaux destinés essentiellement au travail. En Haute Auvergne par exemple, les chevaux de labour (de type comtois) sont apparus après la Seconde Guerre mondiale.
22. Grégoire Chambaz, « Blackout », Revue militaire suisse, septembre 2018.
23. Voilà, à notre sens, un autre angle mort de la réflexion autonomiste. Le tas de compost d’une famille de 4 personnes ne suffit déjà pas à renouveler la fertilité d’un jardin de 500 m2 : il ne permet évidemment pas d’amender les hectares nécessaires à son autonomie alimentaire. Avant que Fritz Haber ne découvre le procédé de synthèse de l’ammoniac à partir de l’azote atmosphérique, l’amendement organique des champs ne nourrissait pas plus de 2 milliards d’individus. De manière plus théorique, on suppose que la seule photosynthèse des plantes cultivées ne pourrait nourrir plus de la moitié des 8 milliards d’humains qui peuplent aujourd’hui la Terre. Or la productivité végétale des cultures est menacée à la fois par l’urbanisation, les labours répétés, la sécheresse et le vent, la pollution et, sans doute un peu plus tard, par la pénurie de gaz naturel et de minéraux (potasse et phosphate) entrant dans la fabrication des engrais « NPK ». Lire à ce propos Hugues Stoeckel, La Faim du monde : l’humanité au bord d’une famine globale, Max Milo Éditions, 2012.
24. II est difficile de se procurer une petite batteuse, dont la plupart sont parties à la casse. Les grosses batteuses mobiles sont beaucoup plus nombreuses sur le marché de l’occasion, mais elles ne peuvent être actionnées sans un moteur de 60 ch. Pour information, le cheval-vapeur français (ch) équivaut à 75 kilogrammètres par seconde, soit la puissance nécessaire pour soulever (verticalement) un poids de 75 kg (le poids d’un objet étant confondu avec sa masse) en une seconde sur une hauteur de 1 mètre. 1 ch = 75 [kg poids] x 1 [mètre]/i [seconde].
25. Jusqu’aux documentaires comme Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent (film de 2015). Olivier de Schutter y était déjà convoqué pour répandre la bonne parole de l’agroécologie.
26. Olivier de Schutter, « Agroécologie et droit à l’alimentation », Rapport présenté à la 16e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, 2011.
27. Lire à ce propos le témoignage des fondateurs de la permaculture eux-mêmes : Masanobu Fukuoka, La Révolution d’un seul brin de paille, Guy Trédaniel Éditeur, 2005 [1975] ; Bill Mollison et David Holmgren, Permaculture : Principes et pistes d’action pour un mode de vie soutenable, éditions Rue de l’Échiquier, 2017 [1978]. Les expérimentations de culture céréalière de Fukuoka ne peuvent faire l’objet d’aucune évaluation, puisque ce pionnier de la permaculture ne cesse de changer d’unité de mesure (nombre de grains par épi, production totale, rendement par unité de terre, etc.) pour apprécier la réussite de son propre travail.
28. Pour une évaluation hilarante du « modèle agroécologique » de Pierre Rabhi, lire l’article publié par FAFIS07, « Terre et humanisme : notre visite chez des agroécologues ardéchois », 28 septembre 2012.
29. À propos de la réussite (communicationnelle) de la Ferme du Bec-Hellouin de Charles et Perrine Hervé-Gruyer, lire Catherine Stevens, « Permaculture et maraîchage biologique, un choix économique intéressant ? », Barricade, 2015.
30. Dans Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert, les deux employés parisiens reconvertis en expérimentateurs champêtres inventent par exemple le « tracteur à poule », que la permaculture revendique toujours comme une innovation.
31. Projet Étude Inra-AgroParisTech — maraîchage biologique permaculturel et performance économique, rapport établi puis actualisé en octobre 2011 ; juillet 2012 ; juillet 2013 ; janvier et décembre 2014 ; novembre 2015 ; février 2017.
32. J’emprunte l’expression à Amélie Grange, Woofing et permaculture : des bacs pour les ZAC, essai non publié.
33. La valeur nutritive de la production maraîchère est très faible : ce que beaucoup considèrent comme un « grand » jardin (1 000 m2) peine à fournir 10 % des calories nécessaires au travailleur lui-même. Lire à ce propos l’article de Stéphane Audrand, « Ce qui nous nourrit principalement : l’autonomie alimentaire et les limites du maraîchage », Plan(s)B info, 6 octobre 2020.
34. La mouture des céréales (et plus encore l’extraction de l’huile contenue dans les oléagineux) est fastidieuse. Pour comprendre, physiquement, ce que représente l’énergie nécessaire à la mouture de 1 kg de blé, on peut raccorder un petit moulin sur un vélo d’appartement. Par expérience, un cycliste régulier peut moudre 1 kg de farine (sans le bluter) en une demi-heure. Étant donné que 1 kg de blé correspond à peu près aux besoins énergétiques journaliers d’une personne, un couple avec deux jeunes enfants devrait consacrer chaque jour deux heures à la simple mouture du blé familial. Si l’on accepte de travailler huit heures par jour, il ne resterait plus que sept heures à chacun des parents-athlètes pour effectuer l’ensemble des autres tâches domestiques.
35. On peut par exemple moissonner sans difficulté quelques ares de blé entre deux pluies. Moissonner les hectares nécessaires à l’autonomie d’une communauté relève en revanche d’un tout autre exercice.
36. Rappelons que la population urbaine dépasse la population rurale mondiale depuis une quinzaine d’années. À titre d’exemple, l’Égypte, qui compte désormais 100 millions d’habitants, s’accroît chaque année de 1 million d’habitants, principalement urbains, tandis que la désertification menace.
37. Les derniers peuples de chasseurs-cueilleurs contemporains vivent soit en zones tropicales humides, extrêmement productives en « biomasse », soit dans les zones polaires ou arides, extrêmement peu peuplées.
L’Inventaire n° 12, automne 2022, 10 euros
aux éditions de la Lenteur,
Le Batz, 81140 Saint-Michel-de-Vax
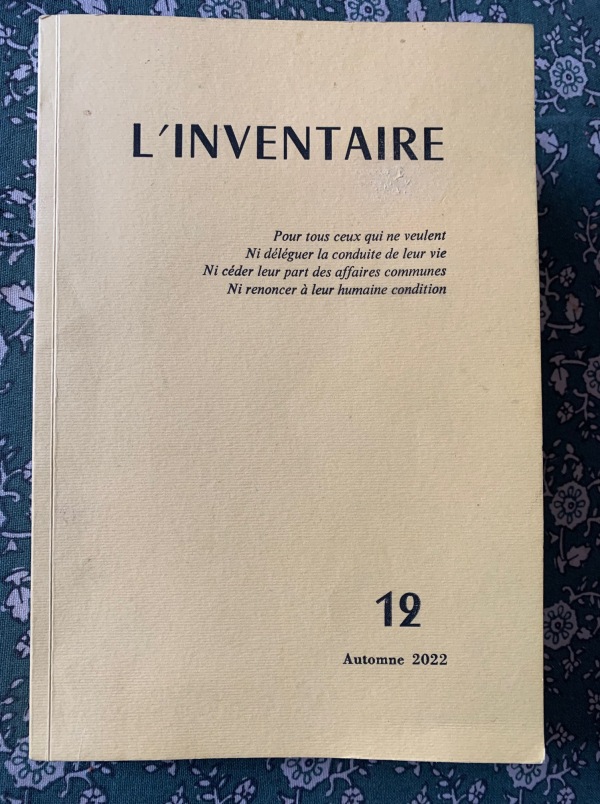
EnColère
/ 25 Mai 2023Quel timing entre sites, des fois 🙂 … cet article de P.Oberlé peut alimenter également les propos de Nicolas et le faire-faire du pétrole permettant le gigantisme productif et des bas coûts des céréales.
https://greenwashingeconomy.com/agriculture-industrielle-aberration-ecologique-sociale-economique/
De cette dépendance toxique, ma question précédente demeure :
Quelle issue et que faire ?
J’aimeJ’aime
EnColère
/ 25 Mai 2023Sur la note n°20, en regardant le barême https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/Chd2207/cd2022-7_Valeur-v%C3%A9nale-des-terresV2.pdf , c’est le maxima qui serait à 12000 pour le Cantal, pas la moyenne.
Normal ou bien inattention ?
Réduire l’autonomie à l’aspect EROI/thermodynamique c’est à dire à la reproductibilité de la force de travail (et tout son arsenal bureaucratique indispensable) chère à Marx sous l’exigence de l’efficacité, pourquoi pas.
Mais, car le climat va évoluer de manière globale, c’est acté, dans une direction où l’agriculture va certainement être impossible à maintenir dans les conditions actuelles, que pense l’auteur de ceci : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328719303507?via%3Dihub ?
Quelle issue et que faire ?
J’aimeJ’aime
les amis de bartleby
/ 24 Mai 2023C’est corrigé, merci.
J’aimeJ’aime
Jef
/ 24 Mai 2023(2+2=5 ?)
Voilà qui s’appelle, mettre les pieds dans le plat des illusions alternatives, le diable est-il encore dans les »détails » ou plutôt dans le plat principal, il va falloir trouver des solutions pérennes (mais existent-elles ?) sinon on passera toujours pour des rigolos voire des fous dangereux !
Quoi qu’il en soit, pour ma part, je pense que les vérités sont toujours bonnes à dire, surtout si elles vont à l’encontre d’illusions aussi graves. Il ne faut pas en rester là… à suivre donc !
Sinon, il manque les notes 19 et 25 à l’intérieur du texte, c’est surtout génant pour la 19…
J’aimeJ’aime