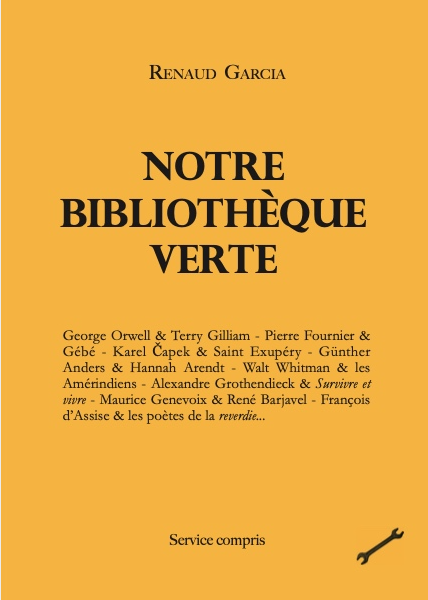Version imprimable de Pierre Fournier et Gébé
Pierre Fournier et Gébé
Mis en ligne par Pièces et main-d’œuvre sur leur site le 2 mars 2021
C’est du 10 juillet 1971, voici 50 ans, un demi-siècle tout rond, et de Saint-Vulbas dans l’Ain (01), que l’on peut dater L’An 01 de la reverdie comme disent les trouvères, avec sa devise encore à accomplir : « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste. »
Ce jour-là, à l’appel de Pierre Fournier (1937-1973) et de Gébé (1929-2004) dans Charlie Hebdo, ainsi que de leurs compagnons du comité Bugey-Cobayes, une sorte de croisade des enfants amena 15 000 marcheurs jusqu’aux grilles de la centrale du Bugey, pour la première grande manifestation anti-nucléaire et anti-industrielle de notre temps.
C’est de cette marche au soleil et de ces deux jours au bord de l’eau que s’ouvrit La Gueule ouverte, « le journal qui annonce la fin du monde » ; et de La Gueule ouverte que jaillirent les mots d’« écologie » et d’« écologistes ». C’est-à-dire le seul mot, la seule idée, le seul mouvement radicalement nouveaux à s’être imposés en politique depuis un demi-siècle : la défense indissociable de la nature et de la liberté ; du « vivant politique » (l’homme, le zoon politikon) dans un monde vivant, et contre l’incarcération de l’homme machine dans un monde machine.
Encore Fournier avait-il hésité : « « Naturistes », « végétariens », je me demande quel terme est le plus inepte, le plus inexact, le plus chargé d’interprétations funambulesques et d’avatars historiques regrettables. Je les refuse tous les deux, mais il n’y en a pas d’autre pour désigner les gens dont, grosso modo, je partage le combat. » (1)
Il y a débat. Nous préférons quant à nous la référence anarchiste « naturiste » (2), clairement sensible, politique et anti-industrielle, mais Fournier se rangea sous l’autorité de l’« écologie » (Haeckel, 1866, Morphologie générale des espèces), de la science à laquelle tout le monde croyait alors, pour démontrer scientifiquement la catastrophe que les aveugles refusent toujours de voir.
Quant au vif, au fluide et subtil Gébé, son art élusif du « pas de côté » face à la Machine chargeant à pleine vitesse, vaut tous les arts martiaux et jeux de stratégie des théoriciens de « l’aliénation » – et avec le sourire encore.
Naturellement, de gauche à droite, les machinistes, technologistes et représentants de la classe technocratique s’efforcèrent – et s’efforcent toujours – d’étouffer, calomnier, infiltrer, récupérer, retourner, ce soulèvement vital et autonome que Ellul (1912-1994) et Charbonneau (1910-1996) avaient dès 1935 qualifié de «révolution» – avant que Fournier ne précise « révolution écologique ». Comme l’on n’est jamais si bien trahi que par les siens, un an après la mort de Fournier, et peu avant la candidature de René Dumont à l’élection présidentielle de 1974, La Gueule ouverte changea de sous-titre pour devenir « hebdomadaire d’écologie politique ». Ce fut le début d’une déchéance dont les technologistes Verts sont aujourd’hui les représentants, et « la croissance verte », le « Green New Deal », le machinisme inclusif, tout le programme. Et on ne vous parle pas des biol’cheviques (sic) qui, à l’instar du fakir Ruffin, de Mélenchon, du NPA et des sectes putschistes, tentent aujourd’hui de tondre la verdure, comme ils s’efforçaient hier de l’expulser du champ politique. Rappelons tout de même un secret de Polichinelle : les journaux du moment 68, ce ne furent pas Rouge, La Cause du Peuple ni Actuel, excroissances parasites de l’intelligentsia bourgeoise, ni même Tout !, avec son slogan de quinzaine commerciale, « Que voulons-nous ? Tout ! », mais Hara-Kiri, Charlie Hebdo et La Gueule ouverte, les seuls et vrais héritiers de la gouaille populaire et libertaire.
Notes
1. Hebdo Hara-Kiri n°43, 24 novembre 1969.
2. Cf. « Tolstoï et les naturiens » – Notre Bibliothèque verte n°8 & 9.
Pièces et main d’œuvre
Pierre Fournier
(1937-1973)
Saint-Vulbas, dans l’Ain, le 10 juillet 1971. 15 000 personnes se rassemblent pour protester contre la construction de la centrale nucléaire du Bugey. C’est le coup d’envoi du mouvement antinucléaire en France. Derrière l’évènement, Pierre Fournier, dessinateur et chroniqueur à Charlie Hebdo. Voix, plume et crayon de la révolution écologiste en France. Ceux qui étaient au Bugey le savent. Les inconditionnels de Charlie aussi. Pour les autres, tous les autres, qui n’ont reçu d’autre image de l’écologie en France que sa caricature politicarde (Europe Écologie Les Verts) ou ses déclinaisons rouges-vertes (les diatribes pseudo-décroissantes du député Ruffin à l’Assemblée nationale), il faut savoir. Et raconter l’histoire de Pierre Fournier.
Né en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, fils d’instituteurs adeptes de la pédagogie de Célestin Freinet mais plutôt conservateurs, Fournier est un élève doué, qui s’intéresse aux langues anciennes et à la philosophie. Il montre très jeune des prédispositions pour le dessin. Ses parents font en sorte de lui offrir un équipement à la hauteur, puis déménagent en 1953 pour la région parisienne, à Nogent-sur-Marne, afin de faciliter ses études d’art. Admirateur de Dürer, Hokusai et Dubout, il entre à l’École nationale supérieure des arts décoratifs, puis réussit le concours de professeur de dessin de la ville de Paris, mais n’exerce pas. Il commence à placer des dessins çà et là dans quelques journaux et magazines, dont Hara-Kiri, en 1962. Ses dessins ne correspondent pas tout à fait à l’esprit du journal animé par Georges Bemier (alias professeur Choron) et François Cavanna, mais ce dernier a remarqué son style. Un trait inquiet, saturé et obscur. Du texte intercalé, des morceaux de bande dessinée, des photographies. Une main qui détonne. En parallèle, pour gagner sa vie, il devient employé à la Caisse des dépôts et consignations. Pour un hebdo « bête et méchant », voilà un rédacteur sérieux, en costume-cravate, affublé de son cabas dans lequel il enfourne des légumes bio. Voyez la couverture de Charlie Hebdo n°34, en date du 12 juillet 1971. « La fête à Bugey », titre le journal, avec un portrait de Fournier par Reiser : costume noir, col blanc, parapluie sous le bras et panier de légumes à la main, levant l’index et disant « je reconnaîtrai tous les enfants conçus pendant la fête ». Un curé. Mais d’une drôle d’engeance, naturiste sinon naturienne.


En 1967, Fournier entre à la rédaction de Hara-Kiri, mensuel puis hebdo, où il côtoie les dessinateurs Wolinski, Reiser, Willem et un certain Georges Blondeaux, dit Gébé, son rédacteur en chef à partir de 1969. Très vite, sous le nom Jean Neyrien Nafoutre de Séquonlat, il se concentre sur les questions de pollution et d’environnement. En 1967, le pétrolier américain Torrey Canyon fait naufrage au large des côtes bretonnes. Les dispersants utilisés pour contrer la marée noire (gazole, napalm) se révèlent plus toxiques encore. La puissance destructrice d’une société industrielle qui se retourne contre la vie est aveuglante pour Fournier. L’Amérique en est l’incarnation, elle qui, par-dessus le marché, colonise culturellement l’Europe avec son capitalisme de la séduction. Pourtant, ce sont aussi les intellectuels américains qui font des pollutions industrielles un sujet central, en remontant du constat aux causes. Déjà le naturaliste Henry Fairfield Osborne, en 1948, dans La planète au pillage (Our Plundered Planet). Puis Rachel Carson et son Printemps silencieux, en 1962, qui attire l’attention sur l’utilisation du DDT. Les érudits savent qu’elle fut devancée par Murray Bookchin, qui avait commencé son engagement écologiste en travaillant sur les contaminations alimentaires. Nul besoin, pour Fournier, de s’autoriser de références aussi pointues pour sembler excentrique aux yeux de la rédaction à Hara-Kiri. Insecticides, marées noires, pollution du Rhin, boues rouges en Méditerranée, saccage du milieu naturel par les équipements industriels (site de Feyzin à Lyon, projet de raffinerie dans les Dombes, exploitation par Péchiney d’une carrière de bauxite sur le site des Baux-de-Provence), urbanisation de Val-Thorens, du Queyras et des Écrins, bétonnage de la côte languedocienne : les sujets de prédilection de Fournier ne sont pas vraiment ceux des autres rédacteurs. Cavanna le décrit comme un « barbu sinistre ». Ses préoccupations pour la nature n’entrent pas dans le cadre progressiste de l’hebdo qui, après 68, s’adresse à un public gauchiste. Pis, elles horripilent le lectorat qui a établi une fois pour toutes les camps, du bon et du mauvais côté de la barrière : « Toi et ta pollution, faut se l’envoyer…C’est une rengaine à la mode et j’aime pas qu’un mec comme toi m’emmerde avec les mêmes histoires que La Vie catho ou autres conneries du genre », lit-on dans un courrier de lecteur des années 1969-1970. Cinquante ans après, cette rengaine reste en effet à la mode : tu ne traites pas du social ; tu ne considères pas que le front principal est le sociétal ; tu penses, ensemble, nature et liberté, alors tu ne vaux pas mieux que l’extrême droite. Quant à Fournier, il se sait anachronique, à contretemps, et s’en fait fort : « Ce que j’ai à dire est difficile à avaler. Vous êtes mûrs, dans l’ensemble, pour en comprendre le quart. L’époque ne pose encore aucun des vrais problèmes ou, plutôt, elle ne pose encore aucun problème correctement, à sa place et dans son ordre ». (3) En note manuscrite en marge de ce texte, Cavanna ajoute ceci : « Fournier, Fournier ! Tu paumes les pédales ! Ce n’est pas parce qu’on te laisse déconner qu’il faut te croire obligé de le faire ». En 1970, lors d’une rencontre au lycée Jeanson de Sailly, Cavanna avoue trouver Fournier « un peu gênant ». Ses chroniques, désormais publiées dans Charlie Hebdo (après l’interdiction de Hara-Kiri en raison de sa une du 16 novembre 1970 « Bal tragique à Colombey : un mort », suite au décès du général de Gaulle) rencontrent néanmoins leur public. Le trait change. Les textes, en petits caractères serrés, se massent sur la page et l’emportent face aux dessins. Fournier porte désormais un message.
Il faut reconnaître à Cavanna la générosité de n’avoir jamais lâché son intempestif chroniqueur. Mieux encore, de lui avoir permis de fonder son propre journal, La Gueule ouverte, afin d’avoir plus d’espace pour développer ses analyses. Pour le reste, l’essentiel dans notre perspective, l’opposition entre les deux hommes est exemplaire du clivage principal de notre temps : technologistes contre écologistes. Le 23 août 1969, dans une chronique intitulée « Il y a trop de paysans », Fournier exprime son souhait de se retirer, à terme, de Hara-Kiri, pour restaurer un vieux village savoyard, Montendry, et y ranimer la vie communautaire. C’est son retour à la terre, la volonté de « maintenir coûte que coûte les bases organiques auxquelles s’attaque notre civilisation suicidaire ». Non pas un repli loin de la réalité sociale, mais la confection d’avant-postes où commencer la révolution de l’existence, avec de nouvelles écoles, des coopératives de production en agriculture biologique, des bibliothèques scientifiques qui poussent à relier et synthétiser les connaissances au lieu d’analyser et disséquer la réalité. Cela rappelle le Giono des marches au Contadour, à partir de 1935. Giono, un des maîtres de Fournier, fabulateur et pacifiste intégral qui, entre 1929 et 1939, invente parallèlement dans ses romans, essais et tracts la critique anti-industrielle en France. Avant même Bernard Charbonneau, qui sera quant à lui l’un des premiers collaborateurs de La Gueule ouverte.
L’essai de Fournier tourne court, faute d’appuis suffisants, mais il revient néanmoins dès 1969 vers la campagne, dans le village de Leyment, dans l’Ain. C’est depuis cet arrière-pays qu’il publiera ses dessins et chroniques, en se déplaçant de moins en moins pour assister aux réunions de rédaction parisiennes. Cavanna, pour sa part, ne remet pas en cause le rôle de la science dans la société. Mieux, il l’exalte, en ses applications technologiques, pour lui confier la réalisation des rêves immémoriaux de l’humanité, tels que l’étemelle jeunesse. La révolution prend un tout autre sens : la subversion des fondements existentiels de l’espèce humaine. En 1976, Cavanna publie le livre Stop-crève (éd. Jean-Jacques Pauvert), qui exalte les possibilités scientifiques d’effacement de la vieillesse. L’intervention sur les processus biologiques permettra d’arrêter la dégradation physique. Vibrionnant d’activité comme de jeunes chiots fougueux, les humains augmentés pourront jouir de tout leur temps sans se consumer dans l’angoisse de la fin. On mourra encore, certes, mais par accident. Comme un animal, jamais plus comme un humain. Qui veut se convaincre du transhumanisme de l’employeur de Fournier lira donc ce livre, et retrouvera l’archive sonore de l’émission Parti-pris, sur France Culture, animée par Jacques Paugam, le 15 décembre 1976.
Cavanna / Fournier. Désormais, la césure politique sépare ceux qui veulent conserver la croissance pour en distribuer les fruits à tous et ceux qui contestent le progrès. Hier comme aujourd’hui, ce déplacement des polarités politiques passe mal. Un lecteur de l’époque : « On s’en fout que les poireaux soient pas sains, l’important c’est qu’il y en ait pour tout le monde ». C’est ce que disent aujourd’hui, en substance, François Ruffin et son ministre de l’économie Frédéric Lordon, en soutien aux travailleurs employés à la fabrication de nuisances. Tels ces salariés frappés en 2016 par la liquidation sauvage de l’usine Écopla (ex-filiale de Péchiney), spécialisée dans la production de barquettes en aluminium : « on s’en fout que l’aluminium soit responsable en partie de l’augmentation de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de Crohn, de scléroses en plaque et de colopathies fonctionnelles, tant que vous pouvez gagner dignement votre vie en produisant à la tonne les récipients toxiques d’une pâtée industrielle toxique ». On force le trait? Pas davantage que Fournier, dont le cri d’alarme dans Hara-Kiri Hebdo n°13, le 28 avril 1969 transforme le chroniqueur en pionnier de la révolution écologiste :
« Pendant qu’on nous amuse avec des guerres et des révolutions qui s’engendrent les unes les autres en répétant toujours la même chose, l’homme est en train, à force d’exploitation technologique incontrôlée, de rendre la terre inhabitable, non seulement pour lui mais pour toutes les formes de vie supérieure qui s’étaient jusqu’alors accommodées de sa présence. Le paradis concentrationnaire qui s’esquisse et que nous promettent ces cons de technocrates ne verra jamais le jour parce que leur ignorance et leur mépris des contingences biologiques le tueront dans l’œuf. La seule vraie question qui se pose n’est pas de savoir s’il sera supportable une fois né mais si, oui ou non, son avortement provoquera notre mort. »
Se rend-on bien compte de ce que signifie ce texte dans le sillage de mai 68, de l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’URSS, des manifestations contre la guerre du Vietnam (l’opération de bombardement américaine Rolling Thunder s’est achevée en novembre 1968) et plus largement des mouvements féministes et noirs américains ? Fournier, le petit employé de la Caisse des dépôts et consignations, adresse à un public d’extrême gauche un message plus révolutionnaire que tout ce que ce dernier serait prêt à endurer. Il est donc suspect de penchants réactionnaires. C’est qu’il remet en question les piliers du progressisme : la technologie et une science devenue folle dans sa prétention à plier le réel à ses méthodes. Tout cela sans jamais renier l’esprit de la science, autrement dit l’effort de comprendre la nature comme un tout, fait de relations multiples. Il utilise dans ce sens le terme « écologie », comme une science des lois de la nature, à laquelle il s’agira de s’exercer pour saisir l’évolution de la matière vivante et signer l’armistice avec la nature. L’adepte de l’alimentation saine ne s’oppose pas brutalement à la science, pas plus qu’il ne verse dans le mysticisme bon marché de ceux qui dénoncent, par ailleurs à juste titre, les impasses de la froide raison. Ni hippie ouvrant les portes de la perception, ni mao englué dans une rhétorique prolétarienne, bien plutôt rétif à toute organisation partidaire, sa filiation se situe du côté de ces naturiens (qu’il appelle « naturistes ») de la Belle Époque, encore actifs dans l’entre-deux guerres : ces ouvriers et petits artisans marginaux, qui avaient secoué le conformisme dans le non-conformisme des milieux libertaires. Contre l’éloge, largement partagé par les anarchistes, du machinisme de la civilisation industrielle qui émancipe des pesanteurs de la glèbe. Au nom du vieil idéal épicurien : celui de la mesure déterminée par les besoins d’une vie saine. En un peu plus de trois ans de frénésie militante, entre 1969 et 1973, à la tribune d’une publication tirant à 150 000 exemplaires, Fournier diffuse l’idée naturienne en France. Il lui donne le nom de « révolution écologique ». Révolution, ou tour complet. Remettre les choses à l’endroit et la réflexion en ordre : « la rivière ne retourne pas à sa source, et la pollution ne vient jamais de l’embouchure. Avant de rationaliser nos rapports avec les autres, il faut rationaliser nos rapports avec nous-mêmes, il faut rationaliser les rapports de notre corps avec l’élémentaire. Avant d’apprendre à parler, apprendre à manger. Apprendre à marcher. À dormir. À respirer. La justice sociale, c’est là qu’elle prend sa source. Ou l’injustice. Et c’est de vous que ça dépend. De toi. De moi. Il faut prendre le problème à la base : là où la liberté humaine COMMENCE. Ce retournement fondamental, c’est le sens de la révolution écologique. » (4) Nature et liberté, indissociables.
Si la gauche française peine à comprendre, le mouvement écologiste américain intéresse beaucoup Fournier, qui entrevoit des promesses dans la Nouvelle Gauche (New Left), parrainée par une figure prestigieuse comme Aldous Huxley. Le movement donne également des idées au génial mathématicien Alexandre Grothendieck, qui fonde, en juillet 1970, avec quelques autres universitaires réunis à Montréal, le « mouvement international pour la survie de l’espèce humaine », nommé Survivre. En plein colloque, celui qui est alors professeur associé au Collège de France, et démissionnaire de l’Institut des hautes études scientifiques (subventionné en partie par le ministère de la Défense) interrompt son intervention pour distribuer à ses collègues une dissertation critiquant la recherche scientifique. Survivre défend des buts écologistes et pacifistes, contre le péril atomique et l’industrialisation galopante, qui incarnent tous deux la volonté de puissance d’une science devenue indiscernable de ses applications techniques et militaires. Le premier bulletin du mouvement paraît en août 1970. Dès la fin de l’année, Grothendieck découvre, enthousiaste, les chroniques de Pierre Fournier. Le mathématicien, qui situe l’alternative entre la révolution écologique et la disparition de l’humanité, rejoint le dessinateur militant. Ils vont œuvrer ensemble, en 1971, au combat antinucléaire, épaulés par plusieurs autres petits groupes : l’Association pour la protection contre les rayonnements ionisants (APRI), fondée par le vétéran de la lutte antinucléaire Jean Pignero ; le Comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR), en partie rejeton de l’APRI, fondé à l’initiative de Françoise Bucher, Esther Peter-Davis et Annick Albrecht, trois militantes opposées au projet de centrale à Fessenheim, dans le Haut-Rhin ; les Amis de la Terre, équivalent français des Friends of the Earth états-uniens ; ou encore Aguigui Mouna, le Diogène de mai 68, qui sillonne Paris à vélo.
C’est aussi l’époque où Fournier est approché par un instituteur rural de la région de Bourg-en- Bresse, Emile Prémillieu. Cet ancien gauchiste multiplie les tentatives d’éducation populaire dans la région lyonnaise. Il s’intéresse au Living Theatre, anime des ciné-clubs, organise des projections suivies de débats dans les usines. Il finit par lire Hara-Kiri et Charlie Hebdo, où les chroniques de Fournier attirent son attention sur le problème nucléaire, aussi bien civil que militaire. Il découvre alors qu’un projet de centrale nucléaire est en cours depuis 1965 dans l’Ain, à Saint-Vulbas. Au culot, il vient frapper à la porte de son voisin Fournier, alors occupé à rassembler des informations sur le projet du Bugey, pendant que se profile, en avril 1971, la première manifestation contre la centrale de Fessenheim. Les deux hommes ne se quitteront plus, du comité Bugey-Cobayes jusqu’au lancement de La Gueule ouverte. Ils se rendent à Fessenheim, Fournier se rapproche du Groupe d’action et de résistance à la militarisation (GARM) et couvre pour Charlie Hebdo des évènements comme l’anti-Quinzaine de l’Environnement, clôturée par la Fête de la Terre, au bois de Vincennes, où l’on remarque à la tribune le sage pacifiste Lanza del Vasto, fondateur de la communauté de l’Arche, et l’écrivain René Barjavel, auteur de Ravage et de La nuit des temps. Aux yeux de Fournier, l’effervescence gagne. Le plus remarquable, c’est que cette accrétion de petits groupes et de francs-tireurs, finissant par former un milieu, ne s’effectue sous la direction d’aucun intellectuel patenté. « Se démerder sans idéologie », voilà un autre trait qui, selon Fournier, distingue l’écologie des sous-groupes trotskistes de l’époque. « C’est la lutte finale », parodie l’auteur dans sa chronique de Charlie Hebdo n°12, le 8 février 1971, en assénant que « nous assistons, à partir des sociétés les plus technicisées, à un soulèvement, encore confus mais universel, du vivant contre ce qui le nie et le détruit, contre le monde irréel que la machine lui fait. Le cheval se cabre à la porte de l’abattoir ». Entre le printemps 1971 et le printemps 1972, avec le point culminant de la marche du Bugey en juillet, Fournier abat un travail insensé. Grâce à sa page dans Charlie, il bénéficie d’une tribune dont aucun de ses compagnons ne peut rêver. Il informe, collecte, synthétise. L’espace du journal devient le relais des divers groupes qui aspirent à se retrouver durant l’été dans l’Ain. Cela fera jaser à Charlie, du côté de Cavanna et Choron : Fournier détournerait le journal comme support de son action. La réciproque est tout aussi vraie : en Bugey, Charlie Hebdo peut toucher un public inhabituel. Toutefois, Choron affrète des bus depuis Paris pour se rendre au Bugey, tandis que l’équipe se rend à la marche. Fournier, quant à lui, veut s’inspirer du travail en cours de Gébé, dans ses planches de L’An 01, pour créer, sur fond de non-violence, un Bugey 01, autrement dit le coup d’envoi de la révolution écologique. La manifestation, qui est un succès, et provoque une petite secousse médiatique, incite Fournier et Prémillieu à déployer par la suite tout l’arsenal militant : marches, sit-in en septembre-octobre devant la centrale de Saint-Vulbas, action « commando pacifique » contre le Palais des nations où se tient une rencontre internationale d’experts sur les applications industrielles de l’atome. Efficacité contrastée. Quelque chose, du moins, s’est passé, au-delà de la politique : « 15 000 mecs sans armes, sans slogans, sans drapeaux, face à l’une des plus grotesques concrétisations du délire ».
Tout ce que Fournier écrit dans cette période est d’une troublante lucidité. D’un côté, le Parti communiste, bien obligé de reconnaître qu’une dimension de la réalité a échappé à sa grille de lecture, s’empare de Bugey 01. Les communistes montrent qu’ils y pensent depuis longtemps, et digèrent l’évènement pour le fondre dans leurs fondamentaux : vaincre le grand capital par l’union des masses. Ce qui signifie, en jargon politisé : « passer à l’action » ou « faire de la politique ». Or, souligne Fournier : « l’action pour l’action, le tract pour le tract, le pavé pour le flic. Tout ceci m’a rapidement fait chier. Vu que l’impasse était toujours au bout. J’ai commencé à penser qu’il existait ailleurs des moyens d’action autrement dangereux que la violence. Et puis, Bugey 01. La force tranquille de 15 000 mecs. Mais il faut qu’il y ait une suite (5) ». Or la suite tarde à se concrétiser. D’un autre côté, il faut se garder d’enterrer le mouvement dans le folklore. On se gausse trop facilement des lubies nudistes, en les confondant à dessein avec la radicalité des naturiens. Quant au retour à la terre, s’il est désirable (et partiellement accompli par Fournier lui-même, qui travaille depuis un village de sa Savoie natale), toute la question reste de savoir avec qui s’y engager. Éreinté à l’automne 1971, Fournier envoie une lettre à Cavanna pour s’excuser de ne pas avoir envoyé d’article à la rédaction. La lettre supplée à une chronique, où le militant fourbu explique : « tant qu’on n’aura pas amené au moins 5 % des gens à un niveau de conscience suffisant pour qu’ils soient obligés d’agir, tout ce qu’on peut faire c’est du mime et de la pantomime. Clownerie. » Plus loin : «je suis à peu près persuadé que tout ce qu’il reste à faire d’intelligent c’est de fonder des communautés. Mais en même temps qu’il n’y a quasi plus d’endroits où ce soit possible, il n’y a pas encore de gens avec qui ce soit possible. Se lancer là-dedans, c’est le meilleur moyen de se faire bouffer tout cru par des gens qui ont encore tout à comprendre. J’aime mieux perdre mon temps à bosser pour Charlie que perdre mon temps à faire le con avec des communautaires foireux ». (6) Allez lire ce texte aux villageois de la montagne ariégeoise ou de la Drôme d’aujourd’hui, évangélisés par les « collapsologues » et leurs techniques de « travail qui relie », de « reconnexion avec le vivant » et de « communication non-violente », il fera probablement écho à leur situation.
Les dilemmes de Fournier restent ceux des anti-industriels, qui malgré le cours catastrophique des choses ne se résignent pas au silence. Tout est perdu, peut-être, fors l’honneur. Qu’il ne soit pas dit que les naturiens aient consenti au désastre : « pendant que je m’escrime à haranguer les cons, ma vie me file entre les doigts. Ce qui est absurde au suprême degré pour un type qui rabâche qu’il faut vivre et que cela seul est important, positif, exemplaire ». Il voudrait arrêter le militantisme et se recentrer sur ce qu’il sait faire de mieux : ajouter de la beauté au monde par ses dessins. Las, le courant l’emporte à nouveau, notamment avec la marche sur le Larzac et la grève de la faim de Lanza del Vasto. En 1972, le rapport du club de Rome sur les limites de la croissance confirme ses vues. Qu’il émane de technocrates et d’industriels lui importe peu, tant que de l’eau est apportée à son moulin. Dans sa volonté de convaincre, il s’appuie également sur la lettre adressée par le commissaire européen à l’agriculture Sicco Mansholt à Franco Maria Malfatti, président de la Commission des communautés européennes. De même que sur le texte Blueprint for Survival, rédigé par Edward Goldsmith dans sa publication The Ecologist. Peu lui chaut qu’on les accuse de malthusianisme ou de penchants réactionnaires, car ces textes posent les questions que devra aborder le mouvement écologiste. Lui qui se dit désormais de gauche, car l’examen rigoureux des faits rend nécessaire le changement de l’état de fait (la révolution écologique) et non le maintien du statu quo (le développement industriel), se lamente de l’imbécilité des gauchistes. Il lit Alexis Carrel, chirurgien, prix Nobel de médecine en 1912, auteur en 1935 de L’Homme, cet inconnu, livre largement diffusé. Politiquement réactionnaire et pétainiste, régent de la Fondation française pour l’étude des problèmes humains, créée en novembre 1941, Carrel promeut par ailleurs un eugénisme plus proche de l’hygiénisme social que des expériences criminelles effectuées auparavant aux États-Unis et en Allemagne (7). Fournier retient de Carrel l’appel à réévaluer les sciences de la matière vivante par rapport aux sciences de la matière inerte. Autrement dit, aborder les rapports entre les êtres vivants et leur milieu comme un tout, au lieu de leur appliquer la méthode des sciences physiques, qui promeut l’analyse au détriment de la synthèse. Mais pour l’homme de gauche, si Carrel le dit, c’est une erreur, puisque Carrel est catholique intégriste et raciste.
Il faudra donc haranguer encore les imbéciles. Informer sans cesse, pour faire droit à la vérité et maintenir vive l’œuvre du comité Bugey-Cobayes. Il s’agit de se dépêcher car, malgré tout, pour les grands médias, le feu est passé au vert. Les récupérateurs se pressent, au premier rang desquels Le Nouvel Observateur, le magazine de la gauche libérale, qui sent le vent tourner. L’écologie est devenue de mode, de sorte qu’à l’été 1972 paraît un numéro spécial intitulé « La dernière chance de la Terre », coordonné par Alain Hervé. Brice Lalonde, ami de ce dernier et futur ministre de l’Environnement entre 1988 et 1992, y présente deux dessins. On y retrouve aussi des contributions d’André Gorz (alias Michel Bosquet) et d’Edgar Morin, le sociologue de la « complexité ». Le grand aïeul des actuels « collapsologues », qui selon Fournier « a une tête de sociologue et le langage de sa tête », découvrira l’année suivante, aux éditions du Seuil, le paradigme perdu, cette nature humaine à réintégrer dans le tissu de la nature. Confronté à cette vague d’usurpateurs, Fournier se sent à l’étroit dans sa rubrique de Charlie, d’autant que Cavanna s’exaspère : Charlie, ce n’est pas le groupe Survivre. Il ne reste pour le chroniqueur qu’à fonder son propre journal écologique. Choron débloque des crédits et facilite la création de La Gueule ouverte en novembre 1972.
Retranchée dans le village savoyard d’Ugine, où Prémillieu a emménagé, une petite équipe issue du comité Bugey prend en charge la rédaction de ce journal « qui annonce la fin du monde », dont la vente des premiers numéros est estimée à 60 000 et 70 000 exemplaires, avec un tirage à 150 000, dans la lignée de ce que pratiquent Hara-Kiri et Charlie Hebdo. Fournier s’adjoint la collaboration des dessinateurs Gavignet et Jean-Pierre Andrevon ; de ses acolytes de Charlie Hebdo Gébé, Cabu, Reiser, Willem et Wolinski ; enfin de Bernard Charbonneau, pour ses chroniques du « terrain vague », autrement dit la banlieue totale issue de la prolifération mécanique de la société industrielle. Alors qu’il emménage avec sa femme et ses enfants dans le petit village de Queige, en Savoie, Fournier enchaîne les trajets en direction de Leyment, où il conserve ses papiers et son matériel, et d’Ugine. Les cinq premiers numéros, bouclés sous la direction de Fournier, se veulent ambitieux, mais la fatigue gagne, tout comme l’inconfort dans la préparation du journal. Dès janvier 1973, les ventes diminuent et Fournier, absorbé par les conditions matérielles de son installation, ne signe aucun article. En février, une réunion se tient à Annecy entre la rédaction du journal et ses lecteurs. Long débat qui laisse Fournier perplexe, sans trop de perspectives sur la suite à donner au journal. Il monte à Paris pour corriger des épreuves. Il y retrouve Cavanna. Nouvelle altercation avec son ami, qui lui est fatale : lui qui avait été opéré d’une malformation cardiaque en 1960, succombe à un infarctus.
Telle est donc la brève histoire de Pierre Fournier. L’histoire, fulgurante, de l’écologie avant les partis écologistes, de la révolte contre la société industrielle avant les accommodements de l’anticapitalisme vert. Laissons, pour terminer, la parole à Charbonneau, auteur de cet hommage dans Le feu vert, en 1980 :
Comme pour les jeunes de sa génération, ignorants du passé, le « problème écologique » avait été une véritable découverte, ce qu’on ne peut dire des vieux convertis sur le tard. Pour crier dans un journal de gauche les méfaits du développement et ses gaspillages, à rebours de la mythologie du progrès matériel, il fallait avoir le courage et la liberté de s’opposer à son propre milieu. Fournier le disait dans le langage des jeunes, mais sans complaisance. Il n’annonçait pas les lendemains qui chantent, mais la fin des temps, pressentant peut-être que le sien était compté. La mort de Fournier est une lourde perte pour le mouvement écologique, car on ne voit guère aujourd’hui qui peut lui maintenir, avec son intransigeance, un sérieux qui n’est pas forcément celui des chiffres.
Renaud Garcia
Hiver 2020-2021
Notes
3. Hara-Kiri n° 39, 27 octobre 1969.
4. Charlie Hebdo n° 40, 23 août 1971.
5. Charlie Hebdo n° 43, 13 septembre 1971.
6. Charlie Hebdo, n°50, 1er novembre 1971.
7. Cf. André Pichot, La société pure. De Darwin à Hitler, Flammation, « Champs », 2000
Lecture
• Danielle Fournier, Patrick Gominet, Fournier, précurseur de l’écologie, Les cahiers dessinés, 2011.
Georges Blondeaux
dit Gébé
(1929-2004)
Quand Gébé vient au monde, l’année du krach de Wall Street, les banquiers américains se jettent par les fenêtres. 1929, ou le début de la Grande Dépression. Plaisant hasard pour un artiste dont le travail respire la créativité, la malice et la joie. De l’aveu de ses proches collaborateurs à Charlie Hebdo, à la vue des images d’archives dont on dispose, il se dégage du personnage une bonhomie, une drôlerie et une humanité exceptionnelles. Tous traits que l’on retrouve dans son utopie de L’An 01, aussi fantaisiste que sérieuse.
Issu d’un milieu modeste, il échoue au baccalauréat en 1945. Deux ans plus tard, il entre à la SNCF (une expérience dont on retrouve des traces dans son art, notamment avec l’album L’âge du fer) et réussit l’examen en le préparant seul. Dessinateur industriel, il débute en 1955 dans le dessin d’humour, notamment dans le magazine La vie du rail. En 1960, il rencontre Cavanna et Georges Bemier (alias Professeur Choron) et intègre la rédaction de Hara-Kiri. Sa patte illustre notamment un numéro sur les « snobs ». Il faut se représenter ce qu’est l’équipe de Hara-Kiri, puis, à partir de 1970, Charlie Hebdo. La quantité de talents (Cabu, Wolinski, Reiser, Fournier, Willem, outre Cavanna et Choron) rassemblés y produit une qualité incomparable dans la presse de l’époque. Rédacteur en chef dès 1969 (il sera directeur de publication lors de la reprise du journal en 1992, jusqu’à sa mort), Gébé est singulier car il s’exprime dans plusieurs registres : le dessin bien sûr, dont il maîtrise toutes les formes, du trait appuyé à l’esquisse, parfois au sein d’une même planche ; mais aussi les sketches, les textes poético-théoriques et les chansons (il en écrira pour Yves Montand ou Juliette Greco). Et bientôt le cinéma, en compagnie d’un réalisateur débutant, Jacques Doillon, qui va agencer les séquences d’un film insolite terminé en 1972 et sorti en salles en 1973, parvenant sans peine à 500 000 entrées. La rançon de la bonne diffusion de Charlie Hebdo, mais aussi de la fraîcheur de cet oasis appelé L’An 01.
Tout commence par quelques planches parues en 1970 dans Politique Hebdo. Et si l’on faisait un pas de côté, demande Gébé ? À l’évidence, n’étant plus là où on l’attend, le travailleur rouage provoquerait l’arrêt de la machine. On voit les scènes : un tel cesse de béer à la fenêtre, se retrouve le nez dans le mur, forcé d’explorer son monde intérieur ; un autre, arrêté sur le bas-côté, apprécie la jouissance tranquille de l’homme qui pisse sans se soucier de s’abriter derrière un arbre, au grand dam de sa bourgeoise ; quant à l’éboueur, il manque la benne et s’amuse à faire des pâtés d’ordures en renversant sa poubelle. Un pas de côté, et on arrête tout. C’est le début du désengrenage. En langage plus savant, la sortie de l’aliénation : on ne colle à son rôle économique que pour mieux le mettre à distance et en révéler l’absurde, dans un grand éclat de rire. Ainsi de ces amants qui se délectent de laisser le réveil sonner à cinq heures, juste pour se dire qu’ils n’iront pas bosser. Ou de ces ouvriers feignant d’attendre, sous la pluie battante, leur bus habituel qui ne passera plus. Et encore ce bricoleur rigolard qui peine à créer une imitation de radiateur à partir de planches de bois, pour mieux le faire brûler dans la cheminée, avant de rameuter, hilare, ses amis : « venez vous chauffer. J’ai allumé le radiateur ! » Dans un texte du 25 mai 1970, intitulé Sans douleur, Gébé écrit :
Et si au lieu de faire un pas en avant, comme le demandent les tacticiens de la Société Nouvelle, nous faisions un pas sur le côté ? – Les queues ne tomberaient plus en face des guichets. – Les fusils tomberaient à côté des recrues. – Les usagers du petit matin ne tomberaient plus en face des portières du bus, des entrées du métro. – Ceux qui par manque de pot, le pas exécuté, se trouveraient en face de la portière, une fois arrivés au boulot pourraient retenter leur chance et là, à tous les coups c’est bon. Un pas de côté et tu t’assoies à côté de ta chaise de bureau. À la chaîne tu n’es plus en face des trous, tu boulonnes dans le vide. – Au comptoir tu bois dans le verre du voisin. Pas grave ! – Au cinéma tu n’es plus en face de la caisse, tu entres sans payer. Au poil ! – Et pour danser, ça ne gêne pas, il suffit de faire ensemble le pas du même côté. – Sur le chantier, un pas de côté et tu montes le mur à la place de la fenêtre. Mais regarde avant si l’échafaudage est assez long. Va pas mettre le pied dans le vide ! Car moi le sang me fait pas bicher. C’est pour ça que je cherche des trucs. Des trucs pour sortir de l’ornière, pour sortir des rails. SANS DOULEUR !
Bref, tout le monde joue, car ce qui était auparavant confisqué dans une représentation, le théâtre du monde livré à domicile par la radio et la télévision, contemplé dans le travail abrutissant et simulé dans les loisirs organisés, retourne à la vie directement vécue. C’est du Debord, pour sûr. Gébé, grand lecteur, cultivé et curieux de tout, ne peut l’ignorer. Mais cette critique-là de la « société du spectacle » ne s’embarrasse pas de paraphrases et retournements de citations de Karl Marx ou du philosophe hongrois Georg Lukàcs pour faire mouche. Elle laisse libre cours à la folie douce de l’imagination et emporte l’adhésion par un rire aussi franc que celui de son auteur. Un rire que Gébé veut partager, car il n’a pas vocation à révolutionner la société technocratique pompidolienne tout seul. Quant à eux, les agents du Plan et de l’Aménagement du territoire, tels l’ingénieur Louis Armand, et Pompidou lui-même, se rendent compte que « l’emprise de l’homme sur la nature est devenue telle qu’elle comporte le risque de la destruction de la nature elle-même ». Au moment où s’accumulent les biens de consommation, le président de la République constate que « ce sont les biens élémentaires les plus nécessaires à la vie, comme l’air et comme l’eau, qui commencent à faire défaut» (Georges Pompidou, discours du 28 février 1970 à Chicago). Bien entendu, la réponse sera typique : seuls les progrès techniques permettront de remédier aux effets néfastes de la société technicienne. Pour Gébé, si l’An 01 voit le jour, on y constatera au contraire que l’équation « progrès = bonheur » est la vraie naïveté, la vraie niaiserie, le grand bluff (planche du 12 juillet 1971).


Le 07 juin 1971, le dessinateur se lance à la rencontre des lecteurs. Il veut faire un film avec son public. Le mot « public » est erroné, du reste. Il ne s’agit plus de spectateurs passifs, mais de futurs acteurs de la « démobilisation » générale. Un arrêt total, laissant à chacun son temps de cerveau disponible pour réfléchir, lire, méditer et se réapproprier, pas à pas, l’héritage littéraire, artistique, scientifique et technique de plusieurs millénaires. Tous derrière la caméra, parce qu’il ne s’agit pas de la fiction forgée par l’esprit d’un seul, mais du sujet le plus brûlant. Et tous devant, « parce qu’il s’agira de mimer un monde décidé à vivre en se mettant de lui-même au point mort, une société ayant stoppé tous ses moteurs, débrayé toutes ses transmissions pour prendre le temps de réfléchir et de décider de son avenir et qu’un tel instant d’une civilisation doit être joué par tous les vivants de cet instant, improvisé par les vivants comme si c’était vrai et pour que ça puisse le devenir ». Pour donner forme à ce soulèvement joyeux des vivants, Gébé dessine pendant un an et demi des planches en forme de saynètes destinées à être jouées par les lecteurs qui le voudront, où qu’ils soient en France. Au volant d’une Renault 16, dotés d’un équipement minimal, lui et Jacques Doillon vont sillonner le pays et reproduire la même routine : débarquer à l’adresse indiquée à Charlie Hebdo, se voir offrir le gîte et le couvert par les futurs acteurs, tourner une scène, puis repartir. Écrivez, et l’on passe vous voir. Un souffle collectif porte ce curieux objet qui n’est pas tout à fait un film, de l’aveu même de Jacques Doillon. Tout le monde veut en être. Aussi verra-t-on plusieurs artistes en devenir, issus pour certains du café-théâtre, participer aux scènes : la troupe du Splendid, Coluche, Daniel Auteuil, Miou-Miou, Pierre Desproges, Jacques Higelin ou encore Gérard Depardieu dans son premier rôle. Les réalisateurs Alain Resnais et Jean Rouch tournent chacun une séquence spéciale pour Gébé. On y voit respectivement des yuppies défenestrés à New York, comme en 1929, suite à l’effondrement des cours de la bourse, et un village africain apprenant par la radio qu’« ils l’ont fait », en Europe : ils ont tout arrêté pour réfléchir. La version finale a été considérablement réduite par rapport au matériau initial accumulé. La lecture, en parallèle, de l’album L’An 01 permet de mieux mesurer l’inventivité de Gébé. On ne peut que décrire ici quelques planches marquantes.
Un dessin du 30 novembre 1970 montre, sur deux colonnes, des travailleurs massés sur le quai de la gare, agglutinés dans les wagons du train puis déversés, en gare, vers les portes des usines et les chaises des bureaux. Guère de différences entre les deux colonnes, hormis des vitres changées en visages souriants, dans la colonne de droite. C’est toujours la même masse, indiscernable, à ceci près que le regard qu’elle porte sur la vie vient de changer. Cet écart préserve la possibilité du pas de côté. Prenez garde, on vous aura prévenus, gardiens de l’ordre et de la normalité : un de ces beaux matins, il est possible que la « masse » file au square, pousse vers la mer ou s’arrête au bistrot. En d’autres termes, qu’elle se soustraie aux plans industriels qui, avec leurs autoroutes, leurs piscines, leurs usines et leurs H.L.M pour regarder la télé, font culminer l’obsession de l’espèce humaine : se distraire d’elle-même pour supporter sa condition de mammifère spirituel (« De l’origine de l’espèce humaine au VIIIe Plan », planche du 10 mai 1971).
Gébé prône l’affirmation de soi, la vie à grands bords, plutôt que l’effacement de soi des numéros jetés à larges brassées entre les mâchoires des machines. Dans l’usine et au dehors. Les amants ne jouent plus le rôle imposé, ils ne font plus de projets d’avenir. Plus besoin de calquer le rythme de la production et disséquer une vie en séquences successives. Ils sont juste là, alanguis sous les draps, ou étendus sur les pelouses, à savourer l’heure. Cela a davantage de sens que de servir l’expansion de la biscuiterie Belin, par exemple, plus grosse fabrique de langues de chat d’Europe, implantée à la jonction de la ville nouvelle d’Évry. La planche du 30 août 1971 montre comment l’industrie recycle les plaisirs de l’enfance pour s’accroître et dévaster de bonnes terres et des forêts. En quelques vignettes, on passe des joies puériles à la construction de la « zone d’activités » (c’est plus avenant que « zone industrielle ») créatrice d’emplois et tournée vers les débouchés internationaux. Chez Gébé, les textes qui entourent les dessins sont précieux. Aussi apprend-on que « pour servir la plus grosse fabrique de langues de chat d’Europe, les CEG [collèges d’enseignement général, NdR] des alentours se chargent d’amener la future main-d’œuvre au niveau de l’emploi, par la crétinisation gratuite et obligatoire ». En bas de la planche, deux questions. La première, du côté d’un gros matou gominé tirant la langue, M. Belin : « connaissez- vous un type du nom de Belin ? A-t-il de si gros besoins d’argent ? » La seconde, accompagnant le visage d’un fou, désemparé devant une assiette dans laquelle traîne un minuscule biscuit : « connaissez-vous un type que le manque de langue de chat rende fou ? » Le décollage industriel semble implacable, mais dès que l’on interroge la finalité du travail et nos aptitudes à l’autonomie, la parade coule de source. Rien à faire contre la publicité et les milliards investis par Belin ? Si ! Transmettre la recette, facile, de la langue de chat : « n’importe qui peut la réussir. Vous n’avez pas besoin de faire chier des gens huit heures par jour toute leur vie pour qu’ils vous fassent vos langues de chat. Avec chacun 100 gr de sucre, 60 gr de farine, 40 gr de beurre et deux œufs, vous pouvez faire crever un trust ».
Alors que son collègue Pierre Fournier vient d’organiser la manifestation antinucléaire du Bugey et utilise sa page dans Charlie Hebdo pour fédérer le mouvement écologiste naissant avec un zèle intransigeant, Gébé poursuit un but semblable par des voies plus légères mais non moins profondes, en relation permanente avec les lecteurs. Parmi les scènes notables filmées par Doillon, citons ce potager sur les trottoirs de Paris, les vestiges du métro où les visiteurs s’exercent à se faufiler entre deux statues massives et rapprochées, mimant la promiscuité vécue chaque jour ouvré par les usagers, ou encore ces musées remplis de babioles, où les humains de L’An 01 contemplent, éberlués, les objets inutiles qui faisaient le quotidien de leurs aînés : des lustres, des miniaspirateurs, des caddies, des appareils électro-ménagers de pointe. Les choses, ou l’histoire des années soixante, telle que Georges Perec l’envisageait dans son roman paru en 1965. Avec L‘An 01, Gébé veut en finir avec cette histoire d’accumulation d’objets qui rendent les hommes à leur image, inertes. La planche du 11 octobre 1971, intitulée « Tract », s’attaque précisément à cette passivité entretenue par la société industrielle. De part et d’autre d’un fil noir, le dessin présente ceux qui sont dans le champ des caméras de télé, et ceux qui sont devant leur poste ; ceux qui écrivent les journaux, et ceux qui les écoutent ; ceux qui font la musique, et ceux qui l’écoutent ; ceux qui font le sport et ceux qui regardent ; ceux qui montrent et ceux qui imitent ; ceux qui font le soleil et ceux qui s’y mettent. En définitive, ceux qui « pédalent dans le système et ceux qui les amusent », juste ce qu’il faut pour donner aux premiers l’impression de vivre. Mais tirez sur le fil noir, dit Gébé, osez vivre par et pour vous-même, et le spectacle permanent s’écroule. Fin de la séparation, fin de la fausse unité sociale : c’est l’An 01. On trouvera difficilement illustration plus fine de la formule situationniste selon laquelle, si le capitalisme industriel réunit le séparé (c’est-à-dire les consommateurs atomisés), il ne le réunit qu’« en tant que séparé ».
Le tournage du film va bon train, des chansons signées François Béranger s’ajoutent aux scènes. Un peu partout, la vie se met à ressembler à L’An 01, comme lorsque les gens jettent vraiment leurs clés dans la rue : « Ouvre ta porte, Retire la clé. Ouvre la fenêtre, Et jette ta clé dans la rue ! ». Les lecteurs participent toujours autant. Parfois pour objecter à l’utopie de la grande démobilisation, comme dans cette lettre d’un certain Jean Blanquet, dessinateur et poète (semble-t-il toujours vivant aujourd’hui, si l’on se fie à un blog Internet), que Gébé, fort amène, cite en intégralité le 22 novembre 1971, en ajoutant qu’il s’agit d’une lettre qu’il aurait pu s’écrire lui-même. L’interlocuteur estime que 01 n’est pas viable, en l’état de la société du début des années 1970, car il invite les gens à revenir à une vie plus simple, centrée sur des besoins limités. Or, réaliser 01 ce serait au contraire dépasser la société existante, œuvre d’un type humain spirituellement supérieur. Ce surpassement de la société établie, ce n’est pas ce que l’interlocuteur de Gébé a vu en germe au Bugey, où régnait selon lui un ennui mortel et ce sentiment que les manifestants étaient venus là pour passer le temps. Écho des critiques abjectes adressées à Fournier, après Bugey, par des groupuscules de la gauche prolétarienne tels que le journal Tout !, fondé entre autres par l’architecte Roland Castro (passé en cinquante ans de Mao à Macron) : les manifestants avaient un week-end de libre, alors ils sont venus se morfondre à la marche. Dans sa lettre à Gébé, Jean Blanquet surenchérit : un type habitué à manger de la viande, si on lui supprime sa ration, ne va pas se convertir à l’ascèse. Il aura faim, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire son besoin. Autrement dit, quand on est pris dans le système des objets et médusé par les mirages de la société de consommation, on peut certes aspirer parfois à des vacances, on ne transigera pas, le reste du temps, sur ses besoins. Offrez aux gens des voitures peu coûteuses et efficaces, ils ne les refuseront pas. À moins, répète le lecteur, qu’un changement spirituel n’intervienne en amont. À moins que l’on interroge le sens de la vie.
Gébé est conduit à approfondir sa réflexion. Jusqu’au 6 novembre 1972, où il déclare que le film est terminé, on se délecte de planches qui touchent au cœur de la vision écologique naissante. L’artiste raille le « socialisme compétitif et de progrès » et ses objectifs grandioses : nationalisation des fumées ; autogestion des déchets ; nuisances égales pour tous ; travail propre, assis et des deux mains ; et un bon livre à 60 ans (17 janvier 1972). Il évoque la « prise de conscience sensuelle » qui raccorde au monde et démystifie le quotidien mécanique et la froideur des rapports hiérarchiques au travail (24 janvier 1972). Une méditation sur la technique se déploie avec une planche illustrant l’échec de la voiture à réaliser le fantasme d’ubiquité (une séquence reprise dans le film). Une autre expose les liens essentiels entre technique et illusion de puissance : vous pourriez laisser filer cet instant de bonheur ou en jouir intensément, mais l’appareil photo le capture dans la boîte ; vous pourriez faire l’expérience de l’immensité d’un paysage qui se refuse à vous, mais le grillage le délimite et le réduit à votre dimension ; vous pourriez philosopher sur l’instinct qui vous pousse à vous démarquer de la masse, mais les marchandises vous assurent de votre originalité « standard ». Pourtant, en dépit de toutes les solutions techniques, les aspirations qui les ont fait naître demeurent (17 juillet 1972). Voyez, pour rester dans le registre du rire intelligent, Blanche Gardin : ce n’est pas parce qu’on a inventé l’avion que l’on a cessé de rêver que l’on vole. Oui, on continue de rêver que l’on vole, et non pas que l’on assemble les pièces d’un Airbus dans un hangar à Toulouse. La fantaisie, c’est d’ailleurs ce qui se réduit à la portion congrue chez l’homme technocratique tel que Gébé le représente : « l’unité peuplante » des zones industrielles, des hectares de bureaux, de grandes surfaces et de parcs de loisir, dispose de plus de capacité d’achat que de capacité intellectuelle, segmenté, quant à son corps, entre le « cancer du fumeur », les « maladies du cœur », les « accidents de voiture », les « journaux-télé » et les sièges de la marque Knoll (« Géographie technocratique », 8 mai 1972).
Le grand désir de Gébé, dès le début, c’est une société qui délibère sur ses véritables besoins. Après l’arrêt général, ne seront ranimés que les services et les productions dont le manque se révélera intolérable. Si l’utopie porte loin, c’est que l’aliment réduit à la cuisson. Il en faut beaucoup au départ pour en retrouver une part substantielle à l’arrivée. Parmi ce qui demeure possible, Gébé promeut l’inventaire des productions de la société industrielle. Le mot même que Simone Weil, pionnière de la critique de l’industrialisme, emploie en 1934 dans ses Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale. Et le titre d’un court-métrage de notre dessinateur. Il y aurait un film à faire, dira-t-il tardivement (captations radio de l’émission Là-bas si j’y suis, en 2002), à la sortie des supermarchés, en inventoriant les caddies pour séparer le nécessaire du superflu et du néfaste. Comme Fournier à la même époque, le rapport du club de Rome, Halte à la croissance !, vient chiffrer ce que l’artiste a perçu avec humour et sensibilité. Et Gébé de s’adresser aux écologistes de La Gueule ouverte : « dites-nous tout, faites-nous peur, mais surtout donnez-nous des envies », pour qu’en comparaison celles que suscite le fric paraissent « mesquines, maigrichonnes et tartes », et pour que les « usines et les bureaux affolés à les satisfaire tombent en panne, en poussière et en ridicule» (02 avril 1973). Une leçon à retenir. Souvent, lorsque le conférencier a terminé de dérouler son argumentaire anti-industriel, vient la question pragmatique : « et, vous, que proposez-vous ? » Gébé nous donne la direction. D’abord, agir par soustraction. Il y a ce que l’on peut faire, et tout ce que l’on peut se permettre de ne pas faire. Frontalement, on appellera cela du boycott. Avec plus de poésie, le pas de côté de L’An 01. Et puis, donner envie, ce qui implique la nécessité de se nommer positivement. D’où la défense et illustration de l’idée naturienne, à travers ses expérimentateurs communards, ses romanciers, ses poètes, ses peintres, ses journalistes, ses théoriciens et donc, ses dessinateurs géniaux, héritiers de 68.
L’utopie de l’An 01 est en effet, pour Gébé, le sujet fondamental aux yeux de ceux pour qui « c’est Mai toute l’année depuis mai ». Au début des années 1970, Sartre distribue La Cause du peuple, l’organe de la Gauche prolétarienne. Gébé, lui, régale ses lecteurs de sa folie douce en déroulant les séquences à venir de son film. S’il évoque l’auteur de la Critique de la raison dialectique, penseur de la masse révolutionnaire en fusion, c’est sous les traits d’un pompiste-écrivain, dans une planche hilarante du 14 août 1972. Contre un plein, l’automobiliste paie Sartre au moyen de bons que l’écrivain encaisse en lui écrivant un livre de sa plus belle plume. Toujours le même : « y’a pas le choix, c’est Les mots ». Pendant que l’écrivain rédige son ouvrage, l’automobiliste se rend au café voisin se procurer quelques remontants pour l’intellectuel, remplacé lors de ses jours de congés par les dessinateur et scénariste Morris et Goscinny. C’est sans doute chez Gébé et Fournier (en dépit des préventions de ce dernier à l’égard de la gauche) que souffle l’élan de Mai 68, celui d’une interrogation radicale du sens de la vie, qui mêle poésie et profondeur, art et intelligence. Davantage que chez Sartre. Et, à l’évidence, bien plus que chez ces « antihumanistes » français (les Deleuze, Foucault, Derrida, Bourdieu, etc., dont l’influence s’est de toute manière déployée longtemps après 68) en qui les « antitotalitaires » Luc Ferry et Alain Renaut ont cru voir l’essence de la pensée 68.
Aujourd’hui, François Ruffin, député « insoumis » de la Somme et admirateur de Cavanna, récupère Gébé dans sa communication biol’chevique (sic), comme son ex-patron avant lui, Daniel Mermet, animateur de l’émission Là-bas si j’y suis, qui diffuse un documentaire de Pierre Carles autour de l’An 01 (des extraits du film entrecoupés d’entretiens avec Gébé, d’émissions de radio et d’archives traitant des débats sur la croissance zéro dans la Communauté européenne au début des années 1970). Les critiques de gauche du néo-libéralisme, bien dans la veine de ce « socialisme compétitif et de progrès » dont Gébé soulignait les impasses d’un œil goguenard, ont vu dans le confinement imposé en mars 2020 l’occasion de recycler la formule « on arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste ». Mais cette fois, au lieu de rompre la distance et de détruire le spectacle de la vie-marchandise, c’est l’accélération de la « distanciation » à tous les niveaux qui s’est produite. Les numéros transformés en troupeau aveugle, au plus grand profit des industriels du numérique et de la santé. Au détriment des pauvres, des vieux, des étudiants, de la parole et de la musique vivante, du contact charnel et de la réflexion. Au point où nous en sommes, nous ne pouvons prendre appui que sur des refus, lesquels, dit Gébé, sont les fondements de toute utopie. En tenant bon, peut-être les barbus à l’hélice au chapeau, personnages initiateurs de L’An 01, reviendront-ils nous voir, semer une belle pagaille et rire un coup. Au cas où, par aventure, on puisse tout arrêter avant que tout ne s’arrête.
Renaud Garcia
Hiver 2020-2021
Lecture
- L’An 01, L’Association, 2014.
- Berck (1965)
- Tout Berck (1992)
- L’Âge du fer ( 1992)
- Une plume pour Clovis (1975)
Etc. -
Les notices de la Bibliothèque verte sont publiées par les éditions Service compris
Bon de commande disponible ici